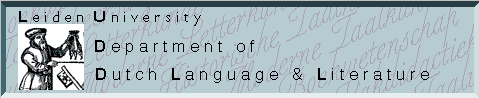
| Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire Discours des trois unités d’action, de jour, et de lieu
Il faut donc savoir quelles sont ces règles; mais notre malheur est qu’Aristote et Horace après lui en ont écrit assez obscurément pour avoir besoin d’interprètes, et que ceux qui leur en ont voulu servir jusques ici ne les ont souvent expliqués qu’en grammairiens ou en philosophes. Comme ils avaient plus d’étude et de spéculation que d’expérience du théâtre, leur lecture nous peut rendre plus doctes, mais non pas nous donner beaucoup de lumières fort sûres pour y réussir. Je hasarderai quelque chose sur cinquante ans de travail pour la scène, et en dirai mes pensées tout simplement, sans esprit de contestation qui m’engage à les soutenir, et sans prétendre que personne renonce en ma faveur à celles qu’il en aura conçues. Ainsi ce que j’ai avancé dès l’entrée de ce discours, que la poésie dramatique a pour but le seul plaisir des spectateurs, n’est pas pour l’emporter opiniâtrement sur ceux qui pensent ennoblir l’art, en lui donnant pour objet de profiter aussi bien que de plaire. Cette dispute même serait très inutile, puisqu’il est impossible de plaire selon les règles, qu’il ne s’y rencontre beaucoup d’utilité. Il est vrai qu’Aristote, dans tout son Traité de la Poétique, n’a jamais employé ce mot une seule fois; qu’il attribue l’origine de la poésie au plaisir que nous prenons à voir imiter les actions des hommes; qu’il préfère la partie du poème qui regarde le sujet à celle qui regarde les moeurs, parce que cette première contient ce qui agrée le plus, comme les agnitions et les péripéties; qu’il fait entrer dans la définition de la tragédie l’agrément du discours dont elle est composée; et qu’il l’estime enfin plus que le poème épique, en ce qu’elle a de plus la décoration extérieure et la musique, qui délectent puissamment, et qu’étant plus courte et moins diffuse, le plaisir qu’on y prend est plus parfait; mais il n’est pas moins vrai qu’Horace nous apprend que nous ne saurions plaire à tout le monde, si nous n’y mêlons l’utile, et que les gens graves et sérieux, les vieillards, les amateurs de la vertu, s’y ennuieront, s’ils n’y trouvent rien à profiter: Centuriae seniorum agitant expertia frugis. Ainsi, quoique l’utile n’y entre que sous la forme du délectable, il ne laisse pas d’y être nécessaire, et il vaut mieux examiner de quelle façon il y peut trouver sa place, que d’agiter, comme je l’ai déjà dit, une question inutile touchant l’utilité de cette sorte de poèmes. J’estime donc qu’il s’y en peut rencontrer de quatre sortes. La première consiste aux sentences et instructions morales qu’on y peut semer presque partout; mais il en faut user sobrement, les mettre rarement en discours généraux, ou ne les pousser guère loin, surtout quand on fait parler un homme passionné, ou qu’on lui fait répondre par un autre; car il ne doit avoir non plus de patience pour les entendre, que de quiétude d’esprit pour les concevoir et les dire. Dans les délibérations d’État, où un homme d’importance consulté par un roi s’explique de sens rassis, ces sortes de discours trouvent lieu de plus d’étendue; mais enfin il est toujours bon de les réduire souvent de la thèse à l’hypothèse; et j’aime mieux faire dire à un acteur, l’amour vous donne beaucoup d’inquiétudes, que, l’amour donne beaucoup d’inquiétudes aux esprits qu’il possède. Ce n’est pas que je voulusse entièrement bannir cette dernière façon de s’énoncer sur les maximes de la morale et de la politique. Tous mes poèmes demeureraient bien estropiés, si on en retranchait ce que j’y en ai mêlé; mais encore un coup, il ne les faut pas pousser loin sans les appliquer au particulier; autrement c’est un lieu commun, qui ne manque jamais d’ennuyer l’auditeur, parce qu’il fait languir l’action; et quelque heureusement que réussisse cet étalage de moralités, il faut toujours craindre que ce ne soit un de ces ornements ambitieux qu’Horace nous ordonne de retrancher. J’avouerai toutefois que les discours généraux ont souvent grâce, quand celui qui les prononce et celui qui les écoute ont tous deux l’esprit assez tranquille pour se donner raisonnablement cette patience. Dans le quatrième acte de Mélite, la joie qu’elle a d’être aimée de Tircis lui fait souffrir sans chagrin la remontrance de sa nourrice, qui de son côté satisfait à cette démangeaison qu’Horace attribue aux vieilles gens, de faire des leçons aux jeunes; mais si elle savait que Tircis la crût infidèle, et qu’il en fût au désespoir, comme elle l’apprend ensuite, elle n’en souffrirait pas quatre vers. Quelquefois même ces discours sont nécessaires pour appuyer des sentiments dont le raisonnement ne se peut fonder sur aucune des actions particulières de ceux dont on parle. Rodogune, au premier acte, ne saurait justifier la défiance qu’elle a de Cléopâtre, que par le peu de sincérité qu’il y a d’ordinaire dans la réconciliation des grands après une offense signalée, parce que, depuis le traité de paix, cette reine n’a rien fait qui la doive rendre suspecte de cette haine qu’elle lui conserve dans le coeur. L’assurance que prend Mélisse, au quatrième de la Suite du Menteur, sur les premières protestations d’amour que lui fait Dorante, qu’elle n’a vu qu’une seule fois, ne se peut autoriser que sur la facilité et la promptitude que deux amants nés l’un pour l’autre ont à donner croyance à ce qu’ils s’entre-disent; et les douze vers qui expriment cette moralité en termes généraux ont tellement plu, que beaucoup de gens d’esprit n’ont pas dédaigné d’en charger leur mémoire. Vous en trouverez ici quelques autres de cette nature. La seule règle qu’on y peut établir, c’est qu’il les faut placer judicieusement, et surtout les mettre en la bouche de gens qui aient l’esprit sans embarras, et qui ne soient point emportés par la chaleur de l’action. La seconde utilité du poème dramatique se rencontre en la naïve peinture des vices et des vertus, qui ne manque jamais à faire son effet, quand elle est bien achevée, et que les traits en sont si reconnaissables qu’on ne les peut confondre l’un dans l’autre, ni prendre le vice pour vertu. Celle-ci se fait alors toujours aimer, quoique malheureuse; et celui-là se fait toujours haïr, bien que triomphant. Les anciens se sont fort souvent contentés de cette peinture, sans se mettre en peine de faire récompenser les bonnes actions, et punir les mauvaises. Clytemnestre et son adultère tuent Agamemnon impunément; Médée en fait autant de ses enfants, et Atrée de ceux de son frère Thyeste, qu’il lui fait manger. Il est vrai qu’à bien considérer ces actions qu’ils choisissaient pour la catastrophe de leurs tragédies, c’étaient des criminels qu’ils faisaient punir, mais par des crimes plus grands que les leurs. Thyeste avait abusé de la femme de son frère; mais la vengeance qu’il en prend a quelque chose de plus affreux que ce premier crime. Jason était un perfide d’abandonner Médée, à qui il devait tout; mais massacrer ses enfants à ses yeux est quelque chose de plus. Clytemnestre se plaignait des concubines qu’Agamemnon ramenait de Troie; mais il n’avait point attenté sur sa vie, comme elle fait sur la sienne; et ces maîtres de l’art ont trouvé le crime de son fils Oreste, qui la tue pour venger son père, encore plus grand que le sien, puisqu’ils lui ont donné des Furies vengeresses pour le tourmenter, et n’en ont point donné à sa mère, qu’ils font jouir paisiblement avec son Egisthe du royaume d’un mari qu’elle avait assassiné. Notre théâtre souffre difficilement de pareils sujets: le Thyeste de Sénèque n’y a pas été fort heureux; sa Médée y a trouvé plus de faveur; mais aussi, à le bien prendre, la perfidie de Jason et la violence du roi de Corinthe la font paraître si injustement opprimée, que l’auditeur entre aisément dans ses intérêts, et regarde sa vengeance comme une justice qu’elle se fait elle-même de ceux qui l’oppriment. C’est cet intérêt qu’on aime à prendre pour les vertueux qui a obligé d’en venir à cette autre manière de finir le poème dramatique par la punition des mauvaises actions et la récompense des bonnes, qui n’est pas un précepte de l’art, mais un usage que nous avons embrassé, dont chacun peut se départir à ses périls. Il était dès le temps d’Aristote, et peut-être qu’il ne plaisait pas trop à ce philosophe, puisqu’il dit qu’il n’a eu vogue que par l’imbécillité du jugement des spectateurs, et que ceux qui le pratiquent s’accommodent au goût du peuple, et écrivent selon les souhaits de leur auditoire. En effet, il est certain que nous ne saurions voir un honnête homme sur notre théâtre sans lui souhaiter de la prospérité, et nous fâcher de ses infortunes. Cela fait que quand il en demeure accablé, nous sortons avec chagrin, et remportons une espèce d’indignation contre l’auteur et les acteurs; mais quand l’événement remplit nos souhaits, et que la vertu y est couronnée, nous sortons avec pleine joie, et remportons une entière satisfaction et de l’ouvrage, et de ceux qui l’ont représenté. Le succès heureux de la vertu, en dépit des traverses et des périls, nous excite à l’embrasser; et le succès funeste du crime ou de l’injustice est capable de nous en augmenter l’horreur naturelle, par l’appréhension d’un pareil malheur. C’est en cela que consiste la troisième utilité du théâtre, comme la quatrième en la purgation des passions par le moyen de la pitié et de la crainte. Mais comme cette utilité est particulière à la tragédie, je m’expliquerai sur cet article au second volume, où je traiterai de la tragédie en particulier, et passe à l’examen des parties qu’Aristote attribue au poème dramatique. Je dis au poème dramatique en général, bien qu’en traitant cette matière il ne parle que de la tragédie; parce que tout ce qu’il en dit convient aussi à la comédie, et que la différence de ces deux espèces de poèmes ne consiste qu’en la dignité des personnages, et des actions qu’ils imitent, et non pas en la façon de les imiter, ni aux choses qui servent à cette imitation. Le poème est composé de deux sortes de parties. Les unes sont appelées parties de quantité, ou d’extension; et Aristote en nomme quatre: le prologue, l’épisode, l’exode et le choeur. Les autres se peuvent nommer des parties intégrantes, qui se rencontrent dans chacune de ces premières pour former tout le corps avec elles. Ce philosophe y en trouve six: le sujet, les moeurs, les sentiments, la diction, la musique, et la décoration du théâtre. De ces six, il n’y a que le sujet dont la bonne constitution dépende proprement de l’art poétique; les autres ont besoin d’autres arts subsidiaires: les moeurs, de la morale; les sentiments, de la rhétorique; la diction, de la grammaire; et les deux autres parties ont chacune leur art, dont il n’est pas besoin que le poète soit instruit, parce qu’il y peut faire suppléer par d’autres que lui, ce qui fait qu’Aristote ne les traite pas. Mais comme il faut qu’il exécute lui-même ce qui concerne les quatre premières, la connaissance des arts dont elles dépendent lui est absolument nécessaire, à moins qu’il ait reçu de la nature un sens commun assez fort et assez profond pour suppléer à ce défaut. Les conditions du sujet sont diverses pour la tragédie et pour la comédie. Je ne toucherai à présent qu’à ce qui regarde cette dernière, qu’Aristote définit simplement une imitation de personnes basses et fourbes. Je ne puis m’empêcher de dire que cette définition ne me satisfait point; et puisque beaucoup de savants tiennent que son Traité de la Poétique n’est pas venu tout entier jusques à nous, je veux croire que dans ce que le temps nous en a dérobé il s’en rencontrait une plus achevée. La poésie dramatique, selon lui, est une imitation des actions, et il s’arrête ici à la condition des personnes, sans dire quelles doivent être ces actions. Quoi qu’il en soit, cette définition avait du rapport à l’usage de son temps, où l’on ne faisait parler dans la comédie que des personnes d’une condition très médiocre; mais elle n’a pas une entière justesse pour le nôtre, où les rois même y peuvent entrer, quand leurs actions ne sont point au-dessus d’elle. Lorsqu’on met sur la scène un simple intrique d’amour entre des rois, et qu’ils ne courent aucun péril, ni de leur vie, ni de leur État, je ne crois pas que, bien que les personnes soient illustres, l’action le soit assez pour s’élever jusqu’à la tragédie. Sa dignité demande quelque grand intérêt d’État, ou quelque passion plus noble et plus mâle que l’amour, telles que sont l’ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d’une maîtresse. Il est à propos d’y mêler l’amour, parce qu’il a toujours beaucoup d’agrément, et peut servir de fondement à ces intérêts, et à ces autres passions dont je parle; mais il faut qu’il se contente du second rang dans le poème, et leur laisse le premier. Cette maxime semblera nouvelle d’abord: elle est toutefois de la pratique des anciens, chez qui nous ne voyons aucune tragédie où il n’y ait qu’un intérêt d’amour à démêler. Au contraire, ils l’en bannissaient souvent; et ceux qui voudront considérer les miennes, reconnaîtront qu’à leur exemple je ne lui ai jamais laissé y prendre le pas devant, et que dans le Cid même, qui est sans contredit la pièce la plus remplie d’amour que j’aie faite, le devoir de la naissance et le soin de l’honneur l’emportent sur toutes les tendresses qu’il inspire aux amants que j’y fais parler. Je dirai plus. Bien qu’il y ait de grands intérêts d’État dans un poème, et que le soin qu’une personne royale doit avoir de sa gloire fasse taire sa passion, comme en Don Sanche, s’il ne s’y rencontre point de péril de vie, de pertes d’États, ou de bannissement, je ne pense pas qu’il ait droit de prendre un nom plus relevé que celui de comédie; mais pour répondre aucunement à la dignité des personnes dont celui-là représente les actions, je me suis hasardé d’y ajouter l’épithète d’héroïque, pour le distinguer d’avec les comédies ordinaires. Cela est sans exemple parmi les anciens; mais aussi il est sans exemple parmi eux de mettre des rois sur le théâtre sans quelqu’un de ces grands périls. Nous ne devons pas nous attacher si servilement à leur imitation, que nous n’osions essayer quelque chose de nous-mêmes, quand cela ne renverse point les règles de l’art; ne fût-ce que pour mériter cette louange que donnait Horace aux poètes de son temps: Nec minimum meruere decus, vestigia groeca Ausi deserere; et n’avoir point de part en ce honteux éloge: O imitatores, servum pecus! Ce qui nous sert maintenant d’exemple, dit Tacite, a été autrefois sans exemple, et ce que nous faisons sans exemple en pourra servir un jour. La comédie diffère donc en cela de la tragédie, que celle-ci veut pour son sujet une action illustre, extraordinaire, sérieuse: celle-là s’arrête à une action commune et enjouée; celle-ci demande de grands périls pour ses héros: celle-là se contente de l’inquiétude et des déplaisirs de ceux à qui elle donne le premier rang parmi ses acteurs. Toutes les deux ont cela de commun, que cette action doit être complète et achevée; c’est-à-dire que dans l’événement qui la termine, le spectateur doit être si bien instruit des sentiments de tous ceux qui y ont eu quelque part, qu’il sorte l’esprit en repos, et ne soit plus en doute de rien. Cinna conspire contre Auguste, sa conspiration est découverte, Auguste le fait arrêter. Si le poème en demeurait là, l’action ne serait pas complète, parce que l’auditeur sortirait dans l’incertitude de ce que cet empereur aurait ordonné de cet ingrat favori. Ptolomée craint que César, qui vient en Égypte, ne favorise sa soeur dont il est amoureux, et ne le force à lui rendre sa part du royaume, que son père lui a laissée par testament: pour attirer la faveur de son côté par un grand service, il lui immole Pompée; ce n’est pas assez, il faut voir comment César recevra ce grand sacrifice. Il arrive, il s’en fâche, il menace Ptolomée, il le veut obliger d’immoler les conseillers de cet attentat à cet illustre mort; ce roi, surpris de cette réception si peu attendue, se résout à prévenir César, et conspire contre lui, pour éviter par sa perte le malheur dont il se voit menacé. Ce n’est pas encore assez; il faut savoir ce qui réussira de cette conspiration. César en a l’avis, et Ptolomée, périssant dans un combat avec ses ministres, laisse Cléopâtre en paisible possession du royaume dont elle demandait la moitié, et César hors de péril; l’auditeur n’a plus rien à demander, et sort satisfait, parce que l’action est complète. Je connais des gens d’esprit, et des plus savants en l’art poétique, qui m’imputent d’avoir négligé d’achever le Cid, et quelques autres de mes poèmes, parce que je n’y conclus pas précisément le mariage des premiers acteurs, et que je ne les envoie point marier au sortir du théâtre. A quoi il est aisé de répondre que le mariage n’est point un achèvement nécessaire pour la tragédie heureuse, ni même pour la comédie. Quant à la première, c’est le péril d’un héros qui la constitue, et lorsqu’il en est sorti, l’action est terminée. Bien qu’il ait de l’amour, il n’est point besoin qu’il parle d’épouser sa maîtresse quand la bienséance ne le permet pas; et il suffit d’en donner l’idée après en avoir levé tous les empêchements, sans lui en faire déterminer le jour. Ce serait une chose insupportable que Chimène en convînt avec Rodrigue dès le lendemain qu’il a tué son père, et Rodrigue serait ridicule, s’il faisait la moindre démonstration de le désirer. Je dis la même chose d’Antiochus. Il ne pourrait dire de douceurs à Rodogune qui ne fussent de mauvaise grâce, dans l’instant que sa mère se vient d’empoisonner à leurs yeux, et meurt dans la rage de n’avoir pu les faire périr avec elle. Pour la comédie, Aristote ne lui impose point d’autre devoir pour conclusion que de rendre amis ceux qui étaient ennemis; ce qu’il faut entendre un peu plus généralement que les termes ne semblent porter, et l’étendre à la réconciliation de toute sorte de mauvaise intelligence; comme quand un fils rentre aux bonnes grâces d’un père qu’on a vu en colère contre lui pour ses débauches, ce qui est une fin assez ordinaire aux anciennes comédies; ou que deux amants, séparés par quelque fourbe qu’on leur a faite, ou par quelque pouvoir dominant, se réunissent par l’éclaircissement de cette fourbe, ou par le consentement de ceux qui y mettaient obstacle; ce qui arrive presque toujours dans les nôtres, qui n’ont que très rarement une autre fin que des mariages. Nous devons toutefois prendre garde que ce consentement ne vienne pas par un simple changement de volonté, mais par un événement qui en fournisse l’occasion. Autrement il n’y aurait pas grand artifice au dénouement d’une pièce, si, après l’avoir soutenue durant quatre actes sur l’autorité d’un père qui n’approuve point les inclinations amoureuses de son fils ou de sa fille, il y consentait tout d’un coup au cinquième, par cette seule raison que c’est le cinquième, et que l’auteur n’oserait en faire six. Il faut un effet considérable qui l’y oblige, comme si l’amant de sa fille lui sauvait la vie en quelque rencontre où il fût prêt d’être assassiné par ses ennemis, ou que par quelque accident inespéré, il fût reconnu pour être de plus grande condition, et mieux dans la fortune qu’il ne paraissait. Comme il est nécessaire que l’action soit complète, il faut aussi n’ajouter rien au-delà, parce que quand l’effet est arrivé, l’auditeur ne souhaite plus rien et s’ennuie de tout le reste. Ainsi les sentiments de joie qu’ont deux amants qui se voient réunis après de longues traverses doivent être bien courts; et je ne sais pas quelle grâce a eue chez les Athéniens la contestation de Ménélas et de Teucer pour la sépulture d’Ajax, que Sophocle fait mourir au quatrième acte; mais je sais bien que de notre temps la dispute du même Ajax et d’Ulysse pour les armes d’Achille après sa mort, lassa fort les oreilles, bien qu’elle partît d’une bonne main. Je ne puis déguiser même que j’ai peine encore à comprendre comment on a pu souffrir le cinquième de Mélite et de la Veuve. On n’y voit les premiers acteurs que réunis ensemble, et ils n’y ont plus d’intérêt qu’à savoir les auteurs de la fausseté ou de la violence qui les a séparés. Cependant ils en pouvaient être déjà instruits, si je l’eusse voulu, et semblent n’être plus sur le théâtre que pour servir de témoins au mariage de ceux du second ordre; ce qui fait languir toute cette fin, où ils n’ont point de part. Je n’ose attribuer le bonheur qu’eurent ces deux comédies à l’ignorance des préceptes, qui était assez générale en ce temps-là, d’autant que ces mêmes préceptes, bien ou mal observés, doivent faire leur effet, bon ou mauvais, sur ceux même qui, faute de les savoir, s’abandonnent au courant des sentiments naturels; mais je ne puis que je n’avoue du moins que la vieille habitude qu’on avait alors à ne voir rien de mieux ordonné a été cause qu’on ne s’est pas indigné contre ces défauts, et que la nouveauté d’un genre de comédie très agréable, et qui jusque-là n’avait point paru sur la scène, a fait qu’on a voulu trouver belles toutes les parties d’un corps qui plaisait à la vue, bien qu’il n’eût pas toutes ses proportions dans leur justesse. La comédie et la tragédie se ressemblent encore en ce que l’action qu’elles choisissent pour imiter doit avoir une juste grandeur, c’est-à-dire qu’elle ne doit être, ni si petite qu’elle échappe à la vue comme un atome, ni si vaste qu’elle confonde la mémoire de l’auditeur et égare son imagination. C’est ainsi qu’Aristote explique cette condition du poème, et ajoute que pour être d’une juste grandeur, elle doit avoir un commencement, un milieu, et une fin. Ces termes sont si généraux, qu’ils semblent ne signifier rien; mais à les bien entendre, ils excluent les actions momentanées qui n’ont point ces trois parties. Telle est peut-être la mort de la soeur d’Horace, qui se fait tout d’un coup sans aucune préparation dans les trois actes qui la précèdent; et je m’assure que si Cinna attendait au cinquième à conspirer contre Auguste, et qu’il consumât les quatre autres en protestations d’amour à Emilie, ou en jalousies contre Maxime, cette conspiration surprenante ferait bien des révoltes dans les esprits, à qui ces quatre premiers auraient fait attendre toute autre chose. Il faut donc qu’une action, pour être d’une juste grandeur, ait un commencement, un milieu et une fin. Cinna conspire contre Auguste et rend compte de sa conspiration à Emilie, voilà le commencement; Maxime en fait avertir Auguste, voilà le milieu; Auguste lui pardonne, voilà la fin. Ainsi dans les comédies de ce premier volume, j’ai presque toujours établi deux amants en bonne intelligence; je les ai brouillés ensemble par quelque fourbe, et les ai réunis par l’éclaircissement de cette même fourbe qui les séparait. A ce que je viens de dire de la juste grandeur de l’action j’ajoute un mot touchant celle de sa représentation, que nous bornons d’ordinaire à un peu moins de deux heures. Quelques-uns réduisent le nombre des vers qu’on y récite à quinze cents, et veulent que les pièces de théâtre ne puissent aller jusqu’à dix-huit, sans laisser un chagrin capable de faire oublier les plus belles choses. J’ai été plus heureux que leur règle ne me le permet, en ayant pour l’ordinaire donné deux mille aux comédies, et un peu plus de dix-huit cents aux tragédies, sans avoir sujet de me plaindre que mon auditoire ait montré trop de chagrin pour cette longueur. C’est assez parlé du sujet de la comédie, et des conditions qui lui sont nécessaires. La vraisemblance en est une dont je parlerai en un autre lieu; il y a de plus, que les événements en doivent toujours être heureux, ce qui n’est pas une obligation de la tragédie, où nous avons le choix de faire un changement de bonheur en malheur, ou de malheur en bonheur. Cela n’a pas besoin de commentaire; je viens à la seconde partie du poème, qui sont les moeurs. Aristote leur prescrit quatre conditions, qu’elles soient bonnes, convenables, semblables, et égales. Ce sont des termes qu’il a si peu expliqués, qu’il nous laisse grand lieu de douter de ce qu’il veut dire. Je ne puis comprendre comment on a voulu entendre par ce mot de bonnes, qu’il faut qu’elles soient vertueuses. La plupart des poèmes, tant anciens que modernes, demeureraient en un pitoyable état, si l’on en retranchait tout ce qui s’y rencontre de personnages méchants, ou vicieux, ou tachés de quelque faiblesse qui s’accorde mal avec la vertu. Horace a pris soin de décrire en général les moeurs de chaque âge, et leur attribue plus de défauts que de perfections; et quand il nous prescrit de peindre Médée fière et indomptable, Ixion perfide, Achille emporté de colère, jusqu’à maintenir que les lois ne sont pas faites pour lui, et ne vouloir prendre droit que par les armes, il ne nous donne pas de grandes vertus à exprimer. Il faut donc trouver une bonté compatible avec ces sortes de moeurs; et s’il m’est permis de dire mes conjectures sur ce qu’Aristote nous demande par là, je crois que c’est le caractère brillant et élevé d’une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu’elle est propre et convenable à la personne qu’on introduit. Cléopâtre, dans Rodogune, est très méchante; il n’y a point de parricide qui lui fasse horreur, pourvu qu’il la puisse conserver sur un trône qu’elle préfère à toutes choses, tant son attachement à la domination est violent; mais tous ses crimes sont accompagnés d’une grandeur d’âme qui a quelque chose de si haut, qu’en même temps qu’on déteste ses actions, on admire la source dont elles partent. J’ose dire la même chose du Menteur. Il est hors de doute que c’est une habitude vicieuse que de mentir; mais il débite ses menteries avec une telle présence d’esprit et tant de vivacité, que cette imperfection a bonne grâce en sa personne, et fait confesser aux spectateurs que le talent de mentir ainsi est un vice dont les sots ne sont point capables. Pour troisième exemple, ceux qui voudront examiner la manière dont Horace décrit la colère d’Achille ne s’éloigneront pas de ma pensée. Elle a pour fondement un passage d’Aristote, qui suit d’assez près celui que je tâche d’expliquer. La poésie, dit-il, est une imitation de gens meilleurs qu’ils n’ont été, et comme les peintres font souvent des portraits flattés, qui sont plus beaux que l’original, et conservent toutefois la ressemblance, ainsi les poètes, représentant des hommes colères ou fainéants, doivent tirer une haute idée de ces qualités qu’ils leur attribuent, en sorte qu’il s’y trouve un bel exemplaire d’équité ou de dureté; et c’est ainsi qu’Homère a fait Achille bon. Ce dernier mot est à remarquer, pour faire voir qu’Homère a donné aux emportements de la colère d’Achille cette bonté nécessaire aux moeurs, que je fais consister en cette élévation de leur caractère, et dont Robortel parle ainsi: Unumquodque genus per se supremos quosdam habet decoris gradus, et absolutissimam recipit formam, non tamen degenerans a sua natura et effigie pristina. Ce texte d’Aristote que je viens de citer peut faire de la peine, en ce qu’il porte que les moeurs des hommes colères ou fainéants doivent être peintes dans un tel degré d’excellence, qu’il s’y rencontre un haut exemplaire d’équité ou de dureté. Il y a du rapport de la dureté à la colère; et c’est ce qu’attribue Horace à celle d’Achille en ce vers: ... Iracundus, inexorabilis, acer. Mais il n’y en a point de l’équité à la fainéantise, et je ne puis voir quelle part elle peut avoir en son caractère. C’est ce qui me fait douter si le mot grec ῥαθίμοὺς a été rendu dans le sens d’Aristote par les interprètes latins que j’ai suivis. Pacius le tourne desides; Victorius, inertes; Heinsius, segnes; et le mot de fainéants, dont je me suis servi pour le mettre en notre langue, répond assez à ces trois versions; mais Castelvetro le rend en la sienne par celui de mansueti, "débonnaires ou pleins de mansuétude; " et non seulement ce mot a une opposition plus juste à celui de colères, mais aussi il s’accorderait mieux avec cette habitude qu’Aristote appelle ἐπιεῖκέιαν, dont il nous demande un bel exemplaire. Ces trois interprètes traduisent ce mot grec par celui d’équité ou de probité, qui répondrait mieux au mansueti de l’Italien qu’à leurs segnes, desides, inertes, pourvu qu’on n’entendît par là qu’une bonté naturelle, qui ne se fâche que malaisément: mais j’aimerais mieux encore celui de piacevolezza, dont l’autre se sert pour l’exprimer en sa langue; et je crois que pour lui laisser sa force en la nôtre, on le pourrait tourner par celui de condescendance, ou facilité équitable d’approuver, excuser, et supporter tout ce qui arrive. Ce n’est pas que je me veuille faire juge entre de si grands hommes; mais je ne puis dissimuler que la version italienne de ce passage me semble avoir quelque chose de plus juste que ces trois latines. Dans cette diversité d’interprétations, chacun est en liberté de choisir, puisque même on a droit de les rejeter toutes, quand il s’en présente une nouvelle qui plaît davantage, et que les opinions des plus savants ne sont pas des lois pour nous. Il me vient encore une autre conjecture, touchant ce qu’entend Aristote par cette bonté de moeurs qu’il leur impose pour première condition. C’est qu’elles doivent être vertueuses tant qu’il se peut, en sorte que nous n’exposions point de vicieux ou de criminels sur le théâtre, si le sujet que nous traitons n’en a besoin. Il donne lieu lui-même à cette pensée, lorsque voulant marquer un exemple d’une faute contre cette règle, il se sert de celui de Ménélas dans l’Oreste d’Euripide, dont le défaut ne consiste pas en ce qu’il est injuste, mais en ce qu’il l’est sans nécessité. Je trouve dans Castelvetro une troisième explication qui pourrait ne déplaire pas, qui est que cette bonté de moeurs ne regarde que le premier personnage, qui doit toujours se faire aimer, et par conséquent être vertueux, et non pas ceux qui le persécutent, ou le font périr; mais comme c’est restreindre à un seul ce qu’Aristote dit en général, j’aimerais mieux m’arrêter, pour l’intelligence de cette première condition, à cette élévation ou perfection de caractère dont j’ai parlé, qui peut convenir à tous ceux qui paraissent sur la scène; et je ne pourrais suivre cette dernière interprétation sans condamner le Menteur, dont l’habitude est vicieuse, bien qu’il tienne le premier rang dans la comédie qui porte ce titre. En second lieu, les moeurs doivent être convenables. Cette condition est plus aisée à entendre que la première. Le poète doit considérer l’âge, la dignité, la naissance, l’emploi et le pays de ceux qu’il introduit: il faut qu’il sache ce qu’on doit à sa patrie, à ses parents, à ses amis, à son roi; quel est l’office d’un magistrat, ou d’un général d’armée, afin qu’il puisse y conformer ceux qu’il veut faire aimer aux spectateurs, et en éloigner ceux qu’il leur veut faire haïr; car c’est une maxime infaillible que, pour bien réussir, il faut intéresser l’auditoire pour les premiers acteurs. Il est bon de remarquer encore que ce qu’Horace dit des moeurs de chaque âge n’est pas une règle dont on ne se puisse dispenser sans scrupule. Il fait les jeunes gens prodigues et les vieillards avares: le contraire arrive tous les jours sans merveille; mais il ne faut pas que l’un agisse à la manière de l’autre, bien qu’il ait quelquefois des habitudes et des passions qui conviendraient mieux à l’autre. C’est le propre d’un jeune homme d’être amoureux, et non pas d’un vieillard; cela n’empêche pas qu’un vieillard ne le devienne: les exemples en sont assez souvent devant nos yeux; mais il passerait pour fou s’il voulait faire l’amour en jeune homme, et s’il prétendait se faire aimer par les bonnes qualités de sa personne. Il peut espérer qu’on l’écoutera, mais cette espérance doit être fondée sur son bien, ou sur sa qualité, et non pas sur ses mérites; et ses prétentions ne peuvent être raisonnables, s’il ne croit avoir affaire à une âme assez intéressée pour déférer tout à l’éclat des richesses, ou à l’ambition du rang. La qualité de semblables, qu’Aristote demande aux moeurs, regarde particulièrement les personnes que l’histoire ou la fable nous fait connaître, et qu’il faut toujours peindre telles que nous les y trouvons. C’est ce que veut dire Horace par ce vers: Sit Medea ferox invictaque... Qui peindrait Ulysse en grand guerrier, ou Achille en grand discoureur, ou Médée en femme fort soumise, s’exposerait à la risée publique. Ainsi ces deux qualités, dont quelques interprètes ont beaucoup de peine à trouver la différence qu’Aristote veut qui soit entre elles sans la désigner, s’accorderont aisément, pourvu qu’on les sépare, et qu’on donne celle de convenables aux personnes imaginées, qui n’ont jamais eu d’être que dans l’esprit du poète, en réservant l’autre pour celles qui sont connues par l’histoire ou par la fable, comme je le viens de dire. Il reste à parler de l’égalité, qui nous oblige à conserver jusqu’à la fin à nos personnages les moeurs que nous leur avons données au commencement: Servetur ad imum Qualis ab incepto processerit, et sibi constet. L’inégalité y peut toutefois entrer sans défaut, non seulement quand nous introduisons des personnes d’un esprit léger et inégal, mais encore lorsqu’en conservant l’égalité au-dedans, nous donnons l’inégalité au-dehors, selon l’occasion. Telle est celle de Chimène, du côté de l’amour; elle aime toujours fortement Rodrigue dans son coeur; mais cet amour agit autrement en la présence du Roi, autrement en celle de l’Infante, et autrement en celle de Rodrigue; et c’est ce qu’Aristote appelle des moeurs inégalement égales. Il se présente une difficulté à éclaircir sur cette matière, touchant ce qu’entend Aristote lorsqu’il dit que la tragédie se peut faire sans moeurs, et que la plupart de celles des modernes de son temps n’en ont point. Le sens de ce passage est assez malaisé à concevoir, vu que, selon lui-même, c’est par les moeurs qu’un homme est méchant ou homme de bien, spirituel ou stupide, timide ou hardi, constant ou irrésolu, bon ou mauvais politique, et qu’il est impossible qu’on en mette aucun sur le théâtre qui ne soit bon ou méchant, et qui n’ait quelqu’une de ces autres qualités. Pour accorder ces deux sentiments qui semblent opposés l’un à l’autre, j’ai remarqué que ce philosophe dit ensuite que si un poète a fait de belles narrations morales et des discours bien sentencieux, il n’a fait encore rien par là qui concerne la tragédie. Cela m’a fait considérer que les moeurs ne sont pas seulement le principe des actions, mais aussi du raisonnement. Un homme de bien agit et raisonne en homme de bien, un méchant agit et raisonne en méchant, et l’un et l’autre étale de diverses maximes de morale suivant cette diverse habitude. C’est donc de ces maximes, que cette habitude produit, que la tragédie peut se passer, et non pas de l’habitude même, puisqu’elle est le principe des actions, et que les actions sont l’âme de la tragédie, où l’on ne doit parler qu’en agissant et pour agir. Ainsi pour expliquer ce passage d’Aristote par l’autre, nous pouvons dire que quand il parle d’une tragédie sans moeurs, il entend une tragédie où les acteurs énoncent simplement leurs sentiments, ou ne les appuient que sur des raisonnements tirés du fait, comme Cléopâtre dans le second acte de Rodogune, et non pas sur des maximes de morale ou de politique, comme Rodogune dans son premier acte. Car, je le répète encore, faire un poème de théâtre où aucun des acteurs ne soit bon ni méchant, prudent ni imprudent, cela est absolument impossible. Après les moeurs viennent les sentiments, par où l’acteur fait connaître ce qu’il veut ou ne veut pas, en quoi il peut se contenter d’un simple témoignage de ce qu’il se propose de faire, sans le fortifier de raisonnements moraux, comme je le viens de dire. Cette partie a besoin de la rhétorique pour peindre les passions et les troubles de l’esprit, pour en consulter, délibérer, exagérer ou exténuer; mais il y a cette différence pour ce regard entre le poète dramatique et l’orateur, que celui-ci peut étaler son art, et le rendre remarquable avec pleine liberté, et que l’autre doit le cacher avec soin, parce que ce n’est jamais lui qui parle, et ceux qu’il fait parler ne sont pas des orateurs. La diction dépend de la grammaire. Aristote lui attribue les figures, que nous ne laissons pas d’appeler communément figures de rhétorique. Je n’ai rien à dire là-dessus, sinon que le langage doit être net, les figures placées à propos et diversifiées, et la versification aisée et élevée au-dessus de la prose, mais non pas jusqu’à l’enflure du poème épique, puisque ceux que le poète fait parler ne sont pas des poètes. Le retranchement que nous avons fait des choeurs a retranché la musique de nos poèmes. Une chanson y a quelquefois bonne grâce, et dans les pièces de machines cet ornement est redevenu nécessaire pour remplir les oreilles de l’auditeur cependant que les machines descendent. La décoration du théâtre a besoin de trois arts pour la rendre belle, de la peinture, de l’architecture, et de la perspective. Aristote prétend que cette partie, non plus que la précédente, ne regarde pas le poète; et comme il ne la traite point, je me dispenserai d’en dire plus qu’il ne m’en a appris. Pour achever ce discours, je n’ai plus qu’à parler des parties de quantité, qui sont le prologue, l’épisode, l’exode et le choeur. Le prologue est ce qui se récite avant le premier chant du choeur; l’épisode, ce qui se récite entre les chants du choeur; et l’exode, ce qui se récite après le dernier chant du choeur. Voilà tout ce que nous en dit Aristote, qui nous marque plutôt la situation de ces parties, et l’ordre qu’elles ont entre elles dans la représentation, que la part de l’action qu’elles doivent contenir. Ainsi pour les appliquer à notre usage, le prologue est notre premier acte, l’épisode fait les trois suivants, l’exode le dernier. Je dis que le prologue est ce qui se récite devant le premier chant du choeur, bien que la version ordinaire porte, devant la première entrée du choeur, ce qui nous embarrasserait fort, vu que dans beaucoup de tragédies grecques le choeur parle le premier, et ainsi elles manqueraient de cette partie, ce qu’Aristote n’eût pas manqué de remarquer. Pour m’enhardir à changer ce terme, afin de lever la difficulté, j’ai considéré qu’en ore que le mot grec πάροδος, dont se sert ici ce philosophe, signifie communément l’entrée en un chemin ou place publique, qui était le lieu ordinaire où nos anciens faisaient parler leurs acteurs, en cet endroit toutefois il ne peut signifier que le premier chant du choeur. C’est ce qu’il m’apprend lui-même un peu après, en disant que le πάροδος du choeur est la première chose que dit tout le choeur ensemble. Or quand le choeur entier disait quelque chose, il chantait; et quand il parlait sans chanter, il n’y avait qu’un de ceux dont il était composé qui parlât au nom de tous. La raison en est que le choeur alors tenait lieu d’acteur, et que ce qu’il disait servait à l’action, et devait par conséquent être entendu; ce qui n’eût pas été possible, si tous ceux qui le composaient, et qui étaient quelquefois jusqu’au nombre de cinquante, eussent parlé ou chanté tous à la fois. Il faut donc rejeter ce premier πάροδος du choeur, qui est la borne du prologue, à la première fois qu’il demeurait seul sur le théâtre et chantait: jusque-là il n’y était introduit que parlant avec un acteur par une seule bouche, ou s’il y demeurait seul sans chanter, il se séparait en deux demi-choeurs, qui ne parlaient non plus chacun de leur côté que par un seul organe, afin que l’auditeur pût entendre ce qu’ils disaient, et s’instruire de ce qu’il fallait qu’il apprît pour l’intelligence de l’action. Je réduis ce prologue à notre premier acte, suivant l’intention d’Aristote, et pour suppléer en quelque façon à ce qu’il ne nous a pas dit, ou que les années nous ont dérobé de son livre, je dirai qu’il doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, tant pour l’action principale que pour les épisodiques, en sorte qu’il n’entre aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit connu par ce premier, ou du moins appelé par quelqu’un qui y aura été introduit. Cette maxime est nouvelle et assez sévère, et je ne l’ai pas toujours gardée; mais j’estime qu’elle sert beaucoup à fonder une véritable unité d’action, par la liaison de toutes celles qui concurrent dans le poème. Les anciens s’en sont fort écartés, particulièrement dans les agnitions, pour lesquelles ils se sont presque toujours servis de gens qui survenaient par hasard au cinquième acte, et ne seraient arrivés qu’au dixième, si la pièce en eût eu dix. Tel est ce vieillard de Corinthe dans l’Oedipe de Sophocle et de Sénèque, où il semble tomber des nues par miracle, en un temps où les acteurs ne sauraient plus par où en prendre, ni quelle posture tenir, s’il arrivait une heure plus tard. Je ne l’ai introduit qu’au cinquième acte non plus qu’eux; mais j’ai préparé sa venue dès le premier, en faisant dire à Oedipe qu’il attend dans le jour la nouvelle de la mort de son père. Ainsi dans la Veuve, bien que Célidan ne paraisse qu’au troisième, il y est amené par Alcidon, qui est du premier. Il n’en est pas de même des Maures dans le Cid, pour lesquels il n’y a aucune préparation au premier acte. Le plaideur de Poitiers dans le Menteur avait le même défaut; mais j’ai trouvé le moyen d’y remédier en cette édition, où le dénouement se trouve préparé par Philiste, et non plus par lui. Je voudrais donc que le premier acte contînt le fondement de toutes les actions, et fermât la porte à tout ce qu’on voudrait introduire d’ailleurs dans le reste du poème. Encore que souvent il ne donne pas toutes les lumières nécessaires pour l’entière intelligence du sujet, et que tous les acteurs n’y paraissent pas, il suffit qu’on y parle d’eux, ou que ceux qu’on y fait paraître aient besoin de les aller chercher pour venir à bout de leurs intentions. Ce que je dis ne se doit entendre que des personnages qui agissent dans la pièce par quelque propre intérêt considérable, ou qui apportent une nouvelle importante qui produit un notable effet. Un domestique qui n’agit que par l’ordre de son maître, un confident qui reçoit le secret de son ami et le plaint dans son malheur, un père qui ne se montre que pour consentir ou contredire le mariage de ses enfants, une femme qui console et conseille son mari: en un mot, tous ces gens sans action n’ont point besoin d’être insinués au premier acte; et quand je n’y aurais point parlé de Livie dans Cinna, j’aurais pu la faire entrer au quatrième, sans pécher contre cette règle. Mais je souhaiterais qu’on l’observât inviolablement quand on fait concurrer deux actions différentes, bien qu’ensuite elles se mêlent ensemble. La conspiration de Cinna, et la consultation d’Auguste avec lui et Maxime, n’ont aucune liaison entre elles, et ne font que concurrer d’abord, bien que le résultat de l’une produise de beaux effets pour l’autre, et soit cause que Maxime en fait découvrir le secret à cet empereur. Il a été besoin d’en donner l’idée dès le premier acte, où Auguste mande Cinna et Maxime. On n’en sait pas la cause; mais enfin il les mande, et cela suffit pour faire une surprise très agréable, de le voir délibérer s’il quittera l’empire ou non, avec deux hommes qui ont conspiré contre lui. Cette surprise aurait perdu la moitié de ses grâces s’il ne les eût point mandés dès le premier acte, ou si on n’y eût point connu Maxime pour un des chefs de ce grand dessein. Dans Don Sanche, le choix que la reine de Castille doit faire d’un mari, et le rappel de celle d’Aragon dans ses États, sont deux choses tout à fait différentes: aussi sont-elles proposées toutes deux au premier acte, et quand on introduit deux sortes d’amours, il ne faut jamais y manquer. Ce premier acte s’appelait prologue du temps d’Aristote, et communément on y faisait l’ouverture du sujet, pour instruire le spectateur de tout ce qui s’était passé avant le commencement de l’action qu’on allait représenter, et de tout ce qu’il fallait qu’il sût pour comprendre ce qu’il allait voir. La manière de donner cette intelligence a changé suivant les temps. Euripide en a usé assez grossièrement, en introduisant, tantôt un dieu dans une machine, par qui les spectateurs recevaient cet éclaircissement, et tantôt un de ses principaux personnages qui les en instruisait lui-même, comme dans son Iphigénie, et dans son Hélène, où ces deux héroïnes racontent d’abord toute leur histoire, et l’apprennent à l’auditeur, sans avoir aucun acteur avec elles à qui adresser leur discours. Ce n’est pas que je veuille dire que quand un acteur parle seul, il ne puisse instruire l’auditeur de beaucoup de choses; mais il faut que ce soit par les sentiments d’une passion qui l’agite, et non pas par une simple narration. Le monologue d’Emilie, qui ouvre le théâtre dans Cinna, fait assez connaître qu’Auguste a fait mourir son père, et que pour venger sa mort elle engage son amant à conspirer contre lui; mais c’est par le trouble et la crainte que le péril où elle expose Cinna jette dans son âme, que nous en avons la connaissance. Surtout le poète se doit souvenir que quand un acteur est seul sur le théâtre, il est présumé ne faire que s’entretenir en lui-même, et ne parle qu’afin que le spectateur sache de quoi il s’entretient, et à quoi il pense. Ainsi ce serait une faute insupportable si un autre acteur apprenait par là ses secrets. On excuse cela dans une passion si violente, qu’elle force d’éclater, bien qu’on n’ait personne à qui la faire entendre, et je ne le voudrais pas condamner en un autre, mais j’aurais de la peine à me le souffrir. Plaute a cru remédier à ce désordre d’Euripide en introduisant un prologue détaché, qui se récitait par un personnage qui n’avait quelquefois autre nom que celui de Prologue, et n’était point du tout du corps de la pièce. Aussi ne parlait-il qu’aux spectateurs pour les instruire de ce qui avait précédé, et amener le sujet jusques au premier acte où commençait l’action. Térence, qui est venu depuis lui, a gardé ses prologues, et en a changé la matière. Il les a employés à faire son apologie contre ses envieux, et pour ouvrir son sujet, il a introduit une nouvelle sorte de personnages, qu’on a appelés protatiques, parce qu’ils ne paraissent que dans la protase, où se doit faire la proposition et l’ouverture du sujet. Ils en écoutaient l’histoire, qui leur était racontée par un autre acteur; et par ce récit qu’on leur en faisait, l’auditeur demeurait instruit de ce qu’il devait savoir, touchant les intérêts des premiers acteurs, avant qu’ils parussent sur le théâtre. Tels sont Sosie dans son Andrienne, et Davus dans son Phormion, qu’on ne revoit plus après la narration, et qui ne servent qu’à l’écouter. Cette méthode est fort artificieuse; mais je voudrais pour sa perfection que ces mêmes personnages servissent encore à quelque autre chose dans la pièce, et qu’ils y fussent introduits par quelque autre occasion que celle d’écouter ce récit. Pollux dans Médée est de cette nature. Il passe par Corinthe en allant au mariage de sa soeur, et s’étonne d’y rencontrer Jason, qu’il croyait en Thessalie; il apprend de lui sa fortune, et son divorce avec Médée, pour épouser Créuse, qu’il aide ensuite à sauver des mains d’Egée, qui l’avait fait enlever, et raisonne avec le Roi sur la défiance qu’il doit avoir des présents de Médée. Toutes les pièces n’ont pas besoin de ces éclaircissements, et par conséquent on se peut passer souvent de ces personnages, dont Térence ne s’est servi que ces deux fois dans les six comédies que nous avons de lui. Notre siècle a inventé une autre espèce de prologue pour les pièces de machines, qui ne touche point au sujet, et n’est qu’une louange adroite du prince devant qui ces poèmes doivent être représentés. Dans l’Andromède, Melpomène emprunte au soleil ses rayons pour éclairer son théâtre en faveur du Roi, pour qui elle a préparé un spectacle magnifique. Le prologue de la Toison d’or, sur le mariage de Sa Majesté et la paix avec l’Espagne, a quelque chose encore de plus éclatant. Ces prologues doivent avoir beaucoup d’invention; et je ne pense pas qu’on y puisse raisonnablement introduire que des Dieux imaginaires de l’antiquité, qui ne laissent pas toutefois de parler des choses de notre temps, par une fiction poétique, qui fait un grand accommodement de théâtre. L’épisode, selon Aristote, en cet endroit, sont nos trois actes du milieu; mais comme il applique ce nom ailleurs aux actions qui sont hors de la principale, et qui lui servent d’un ornement dont elle se pourrait passer, je dirai que bien que ces trois actes s’appellent épisode, ce n’est pas à dire qu’ils ne soient composés que d’épisodes. La consultation d’Auguste au second de Cinna, les remords de cet ingrat, ce qu’il en découvre à Emilie, et l’effort que fait Maxime pour persuader à cet objet de son amour caché de s’enfuir avec lui, ne sont que des épisodes; mais l’avis que fait donner Maxime par Euphorbe à l’Empereur, les irrésolutions de ce prince, et les conseils de Livie, sont de l’action principale; et dans Héraclius, ces trois actes ont plus d’action principale que d’épisodes. Ces épisodes sont de deux sortes, et peuvent être composés des actions particulières des principaux acteurs, dont toutefois l’action principale pourrait se passer, ou des intérêts des seconds amants qu’on introduit, et qu’on appelle communément des personnages épisodiques. Les uns et les autres doivent avoir leur fondement dans le premier acte, et être attachés à l’action principale, c’est-à-dire y servir de quelque chose; et particulièrement ces personnages épisodiques doivent s’embarrasser si bien avec les premiers, qu’un seul intrique brouille les uns et les autres. Aristote blâme fort les épisodes détachés, et dit que les mauvais poètes en font par ignorance, et les bons en faveur des comédiens pour leur donner de l’emploi. L’Infante du Cid est de ce nombre, et on la pourra condamner ou lui faire grâce par ce texte d’Aristote, suivant le rang qu’on voudra me donner parmi nos modernes. Je ne dirai rien de l’exode, qui n’est autre chose que notre cinquième acte. Je pense en avoir expliqué le principal emploi, quand j’ai dit que l’action du poème dramatique doit être complète. Je n’y ajouterai que ce mot: qu’il faut, s’il se peut, lui réserver toute la catastrophe, et même la reculer vers la fin, autant qu’il est possible. Plus on la diffère, plus les esprits demeurent suspendus, et l’impatience qu’ils ont de savoir de quel côté elle tournera est cause qu’ils la reçoivent avec plus de plaisir: ce qui n’arrive pas quand elle commence avec cet acte. L’auditeur qui la sait trop tôt n’a plus de curiosité; et son attention languit durant tout le reste, qui ne lui apprend rien de nouveau. Le contraire s’est vu dans la Mariane, dont la mort, bien qu’arrivée dans l’intervalle qui sépare le quatrième acte du cinquième, n’a pas empêché que les déplaisirs d’Hérode, qui occupent tout ce dernier, n’aient plu extraordinairement; mais je ne conseillerais à personne de s’assurer sur cet exemple. Il ne se fait pas des miracles tous les jours; et quoique son auteur eût bien mérité ce beau succès par le grand effort d’esprit qu’il avait fait à peindre les désespoirs de ce monarque, peut-être que l’excellence de l’acteur qui en soutenait le personnage, y contribuait beaucoup. Voilà ce qui m’est venu en pensée touchant le but, les utilités, et les parties du poème dramatique. Quelques personnes de condition, qui peuvent tout sur moi, ont voulu que je donnasse mes sentiments au public sur les règles d’un art qu’il y a si longtemps que je pratique assez heureusement. Comme ce recueil est séparé en trois volume, j’ai séparé les principales matières en trois Discours, pour leur servir de préfaces. Je parle au second des conditions particulières de la tragédie, des qualités des personnes et des événements qui lui peuvent fournir de sujet, et de la manière de le traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire. Je m’explique dans le troisième sur les trois unités, d’action, de jour, et de lieu. Cette entreprise méritait une longue et très exacte étude de tous les poèmes qui nous restent de l’antiquité, et de tous ceux qui ont commenté les traités qu’Aristote et Horace ont faits de l’art poétique, ou qui en ont écrit en particulier; mais je n’ai pu me résoudre à en prendre le loisir; et je m’assure que beaucoup de mes lecteurs me pardonneront aisément cette paresse, et ne seront pas fâchés que je donne à des productions nouvelles le temps qu’il m’eût fallu consumer à des remarques sur celles des autres siècles. J’y fais quelques courses, et y prends des exemples quand ma mémoire m’en peut fournir. Je n’en cherche de modernes que chez moi, tant parce que je connais mieux mes ouvrages que ceux des autres, et en suis plus le maître, que parce que je ne veux pas m’exposer au péril de déplaire à ceux que je reprendrais en quelque chose, ou que je ne louerais pas assez en ce qu’ils ont fait d’excellent. J’écris sans ambition et sans esprit de contestation, je l’ai déjà dit. Je tâche de suivre toujours le sentiment d’Aristote dans les matières qu’il a traitées; et comme peut-être je l’entends à ma mode, je ne suis point jaloux qu’un autre l’entende à la sienne. Le commentaire dont je m’y sers le plus est l’expérience du théâtre et les réflexions sur ce que j’ai vu y plaire ou déplaire. J’ai pris pour m’expliquer un style simple, et me contente d’une expression nue de mes opinions, bonnes ou mauvaises, sans y rechercher aucun enrichissement d’éloquence. Il me suffit de me faire entendre; je ne prétends pas qu’on admire ici ma façon d’écrire, et ne fais point de scrupule de m’y servir souvent des mêmes termes, ne fût-ce que pour épargner le temps d’en chercher d’autres, dont peut-être la variété ne dirait pas si justement ce que je veux dire. J’ajoute à ces trois Discours généraux l’examen de chacun de mes poèmes en particulier, afin de voir en quoi ils s’écartent ou se conforment aux règles que j’établis. Je n’en dissimulerai point les défauts, et en revanche je me donnerai la liberté de remarquer ce que j’y trouverai de moins imparfait. Balzac accorde ce privilège à une certaine espèce de gens, et soutient qu’ils peuvent dire d’eux-mêmes par franchise ce que d’autres diraient par vanité. Je ne sais si j’en suis; mais je veux avoir assez bonne opinion de moi pour n’en désespérer pas.
Nous avons pitié, dit-il, de ceux que nous voyons souffrir un malheur qu’ils ne méritent pas, et nous craignons qu’il ne nous en arrive un pareil, quand nous le voyons souffrir à nos semblables. Ainsi la pitié embrasse l’intérêt de la personne que nous voyons souffrir, la crainte qui la suit regarde la nôtre, et ce passage seul nous donne assez d’ouverture pour trouver la manière dont se fait la purgation des passions dans la tragédie. La pitié d’un malheur où nous voyons tomber nos semblables nous porte à la crainte d’un pareil pour nous; cette crainte, au désir de l’éviter; et ce désir, à purger, modérer, rectifier, et même déraciner en nous la passion qui plonge à nos yeux dans ce malheur les personnes que nous plaignons, par cette raison commune, mais naturelle et indubitable, que pour éviter l’effet il faut retrancher la cause. Cette explication ne plaira pas à ceux qui s’attachent aux commentateurs de ce philosophe. Ils se gênent sur ce passage, et s’accordent si peu l’un avec l’autre, que Paul Beni marque jusqu’à douze ou quinze opinions diverses, qu’il réfute avant que de nous donner la sienne. Elle est conforme à celle-ci pour le raisonnement, mais elle diffère en ce point, qu’elle n’en applique l’effet qu’aux rois et aux princes, peut-être par cette raison que la tragédie ne peut nous faire craindre que les maux que nous voyons arriver à nos semblables, et que n’en faisant arriver qu’à des rois et à des princes, cette crainte ne peut faire d’effet que sur des gens de leur condition. Mais sans doute il a entendu trop littéralement ce mot de nos semblables, et n’a pas assez considéré qu’il n’y avait point de rois à Athènes, où se représentaient les poèmes dont Aristote tire ses exemples, et sur lesquels il forme ses règles. Ce philosophe n’avait garde d’avoir cette pensée qu’il lui attribue, et n’eût pas employé dans la définition de la tragédie une chose dont l’effet pût arriver si rarement, et dont l’utilité se fût restreinte à si peu de personnes. Il est vrai qu’on n’introduit d’ordinaire que des rois pour premiers acteurs dans la tragédie, et que les auditeurs n’ont point de sceptres par où leur ressembler, afin d’avoir lieu de craindre les malheurs qui leur arrivent; mais ces rois sont hommes comme les auditeurs, et tombent dans ces malheurs par l’emportement des passions dont les auditeurs sont capables. Ils prêtent même un raisonnement aisé à faire du plus grand au moindre; et le spectateur peut concevoir avec facilité que si un roi, pour trop s’abandonner à l’ambition, à l’amour, à la haine, à la vengeance, tombe dans un malheur si grand qu’il lui fait pitié, à plus forte raison lui qui n’est qu’un homme du commun doit tenir la bride à de telles passions, de peur qu’elles ne l’abîment dans un pareil malheur. Outre que ce n’est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre. Celles des autres hommes y trouveraient place, s’il leur en arrivait d’assez illustres et d’assez extraordinaires pour la mériter, et que l’histoire prît assez de soin d’eux pour nous les apprendre. Scédase n’était qu’un paysan de Leuctres; et je ne tiendrais pas la sienne indigne d’y paraître, si la pureté de notre scène pouvait souffrir qu’on y parlât du violement effectif de ses deux filles, après que l’idée de la prostitution n’y a pu être soufferte dans la personne d’une sainte qui en fut garantie. Pour nous faciliter les moyens de faire naître cette pitié et cette crainte où Aristote semble nous obliger, il nous aide à choisir les personnes et les événements qui peuvent exciter l’une et l’autre. Sur quoi je suppose, ce qui est très véritable, que notre auditoire n’est composé ni de méchants, ni de saints, mais de gens d’une probité commune, et qui ne sont pas si sévèrement retranchés dans l’exacte vertu, qu’ils ne soient susceptibles des passions et capables des périls où elles engagent ceux qui leur défèrent trop. Cela supposé, examinons ceux que ce philosophe exclut de la tragédie, pour en venir avec lui à ceux dans lesquels il fait consister sa perfection. En premier lieu, il ne veut point qu’un homme fort vertueux y tombe de la félicité dans le malheur, et soutient que cela ne produit ni pitié, ni crainte, parce que c’est un événement tout à fait injuste. Quelques interprètes poussent la force de ce mot grec ***, qu’il fait servir d’épithète à cet événement, jusqu’à le rendre par celui d’abominable; à quoi j’ajoute qu’un tel succès excite plus d’indignation et de haine contre celui qui fait souffrir, que de pitié pour celui qui souffre, et qu’ainsi ce sentiment, qui n’est pas le propre de la tragédie, à moins que d’être bien ménagé, peut étouffer celui qu’elle doit produire, et laisser l’auditeur mécontent par la colère qu’il remporte, et qui se mêle à la compassion, qui lui plairait s’il la remportait seule. Il ne veut pas non plus qu’un méchant homme passe du malheur à la félicité, parce que non seulement il ne peut naître d’un tel succès aucune pitié, ni crainte, mais il ne peut pas même nous toucher par ce sentiment naturel de joie dont nous remplit la prospérité d’un premier acteur, à qui notre faveur s’attache. La chute d’un méchant dans le malheur a de quoi nous plaire par l’aversion que nous prenons pour lui; mais comme ce n’est qu’une juste punition, elle ne nous fait point de pitié, et ne nous imprime aucune crainte, d’autant que nous ne sommes pas si méchants que lui, pour être capables de ses crimes, et en appréhender une aussi funeste issue. Il reste donc à trouver un milieu entre ces deux extrémités, par le choix d’un homme qui ne soit ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant, et qui, par une faute, ou faiblesse humaine, tombe dans un malheur qu’il ne mérite pas. Aristote en donne pour exemples Oedipe et Thyeste, en quoi véritablement je ne comprends point sa pensée. Le premier me semble ne faire aucune faute, bien qu’il tue son père, parce qu’il ne le connaît pas, et qu’il ne fait que disputer le chemin en homme de coeur contre un inconnu qui l’attaque avec avantage. Néanmoins, comme la signification du mot grec *** peut s’étendre à une simple erreur de méconnaissance, telle qu’était la sienne, admettons-le avec ce philosophe, bien que je ne puisse voir quelle passion il nous donne à purger, ni de quoi nous pouvons nous corriger sur son exemple. Mais pour Thyeste, je n’y puis découvrir cette probité commune, ni cette faute sans crime qui le plonge dans son malheur. Si nous le regardons avant la tragédie qui porte son nom, c’est un incestueux qui abuse de la femme de son frère; si nous le considérons dans la tragédie, c’est un homme de bonne foi qui s’assure sur la parole de son frère, avec qui il s’est réconcilié. En ce premier état il est très criminel; en ce dernier, très homme de bien. Si nous attribuons son malheur à son inceste, c’est un crime dont l’auditoire n’est point capable, et la pitié qu’il prendra de lui n’ira point jusqu’à cette crainte qui purge, parce qu’il ne lui ressemble point. Si nous imputons son désastre à sa bonne foi, quelque crainte pourra suivre la pitié que nous en aurons; mais elle ne purgera qu’une facilité de confiance sur la parole d’un ennemi réconcilié, qui est plutôt une qualité d’honnête homme qu’une vicieuse habitude; et cette purgation ne fera que bannir la sincérité des réconciliations. J’avoue donc avec franchise que je n’entends point l’application de cet exemple. J’avouerai plus. Si la purgation des passions se fait dans la tragédie, je tiens qu’elle se doit faire de la manière que je l’explique; mais je doute si elle s’y fait jamais, et dans celles-là même qui ont les conditions que demande Aristote. Elles se rencontrent dans le Cid, et en ont causé le grand succès: Rodrigue et Chimène y ont cette probité sujette aux passions, et ces passions font leur malheur, puisqu’ils ne sont malheureux qu’autant qu’ils sont passionnés l’un pour l’autre. Ils tombent dans l’infélicité par cette faiblesse humaine dont nous sommes capables comme eux; leur malheur fait pitié, cela est constant, et il en a coûté assez de larmes aux spectateurs pour ne le point contester. Cette pitié nous doit donner une crainte de tomber dans un pareil malheur, et purger en nous ce trop d’amour qui cause leur infortune et nous les fait plaindre; mais je ne sais si elle nous la donne, ni si elle le purge, et j’ai bien peur que le raisonnement d’Aristote sur ce point ne soit qu’une belle idée, qui n’ait jamais son effet dans la vérité. Je m’en rapporte à ceux qui en ont vu les représentations: ils peuvent en demander compte au secret de leur coeur, et repasser sur ce qui les a touchés au théâtre, pour reconnaître s’ils en sont venus par là jusqu’à cette crainte réfléchie, et si elle a rectifié en eux la passion qui a causé la disgrâce qu’ils ont plainte. Un des interprètes d’Aristote veut qu’il n’ait parlé de cette purgation des passions dans la tragédie que parce qu’il écrivait après Platon, qui bannit les poètes tragiques de sa république, parce qu’ils les remuent trop fortement. Comme il écrivait pour le contredire, et montrer qu’il n’est pas à propos de les bannir des États bien policés, il a voulu trouver cette utilité dans ces agitations de l’âme, pour les rendre recommandables par la raison même sur qui l’autre se fonde pour les bannir. Le fruit qui peut naître des impressions que fait la force de l’exemple lui manquait: la punition des méchantes actions, et la récompense des bonnes, n’étaient pas de l’usage de son siècle, comme nous les avons rendues de celui du nôtre; et n’y pouvant trouver une utilité solide, hors celle des sentences et des discours didactiques, dont la tragédie se peut passer selon son avis, il en a substitué une qui peut-être n’est qu’imaginaire. Du moins, si pour la produire il faut les conditions qu’il demande, elles se rencontrent si rarement, que Robortel ne les trouve que dans le seul Oedipe, et soutient que ce philosophe ne nous les prescrit pas comme si nécessaires que leur manquement rende un ouvrage défectueux, mais seulement comme des idées de la perfection des tragédies. Notre siècle les a vues dans le Cid, mais je ne sais s’il les a vues en beaucoup d’autres; et si nous voulons rejeter un coup d’oeil sur cette règle, nous avouerons que le succès a justifié beaucoup de pièces où elle n’est pas observée. L’exclusion des personnes tout à fait vertueuses qui tombent dans le malheur bannit les martyrs de notre théâtre. Polyeucte y a réussi contre cette maxime, et Héraclius et Nicomède y ont plu, bien qu’ils n’impriment que de la pitié, et ne nous donnent rien à craindre, ni aucune passion à purger, puisque nous les y voyons opprimés et près de périr, sans aucune faute de leur part dont nous puissions nous corriger sur leur exemple. Le malheur d’un homme fort méchant n’excite ni pitié, ni crainte, parce qu’il n’est pas digne de la première, et que les spectateurs ne sont pas méchants comme lui pour concevoir l’autre à la vue de sa punition; mais il serait à propos de mettre quelque distinction entre les crimes. Il en est dont les honnêtes gens sont capables par une violence de passion, dont le mauvais succès peut faire effet dans l’âme de l’auditeur. Un honnête homme ne va pas voler au coin d’un bois, ni faire un assassinat de sang-froid; mais s’il est bien amoureux, il peut faire une supercherie à son rival, il peut s’emporter de colère et tuer dans un premier mouvement, et l’ambition le peut engager dans un crime ou dans une action blâmable. Il est peu de mères qui voulussent assassiner ou empoisonner leurs enfants de peur de leur rendre leur bien, comme Cléopâtre dans Rodogune; mais il en est assez qui prennent goût à en jouir, et ne s’en dessaisissent qu’à regret et le plus tard qu’il leur est possible. Bien qu’elles ne soient pas capables d’une action si noire et si dénaturée que celle de cette reine de Syrie, elles ont en elles quelque teinture du principe qui l’y porta, et la vue de la juste punition qu’elle en reçoit leur peut faire craindre, non pas un pareil malheur, mais une infortune proportionnée à ce qu’elles sont capables de commettre. Il en est ainsi de quelques autres crimes qui ne sont pas de la portée de nos auditeurs. Le lecteur en pourra faire l’examen et l’application sur cet exemple. Cependant, quelque difficulté qu’il y ait à trouver cette purgation effective et sensible des passions par le moyen de la pitié et de la crainte, il est aisé de nous accommoder avec Aristote. Nous n’avons qu’à dire que par cette façon de s’énoncer il n’a pas entendu que ces deux moyens y servissent toujours ensemble; et qu’il suffit selon lui de l’un des deux pour faire cette purgation, avec cette différence toutefois, que la pitié n’y peut arriver sans la crainte, et que la crainte peut y parvenir sans la pitié. La mort du Comte n’en fait aucune dans le Cid, et peut toutefois mieux purger en nous cette sorte d’orgueil envieux de la gloire d’autrui, que toute la compassion que nous avons de Rodrigue et de Chimène ne purge les attachements de ce violent amour qui les rend à plaindre l’un et l’autre. L’auditeur peut avoir de la commisération pour Antiochus, pour Nicomède, pour Héraclius; mais s’il en demeure là, et qu’il ne puisse craindre de tomber dans un pareil malheur, il ne guérira d’aucune passion. Au contraire, il n’en a point pour Cléopâtre, ni pour Prusias, ni pour Phocas; mais la crainte d’une infortune semblable ou approchante peut purger en une mère l’opiniâtreté à ne se point dessaisir du bien de ses enfants, en un mari le trop de déférence à une seconde femme au préjudice de ceux de son premier lit, en tout le monde l’avidité d’usurper le bien ou la dignité d’autrui par la violence; et tout cela proportionnément à la condition d’un chacun et à ce qu’il est capable d’entreprendre. Les déplaisirs et les irrésolutions d’Auguste dans Cinna peuvent faire ce dernier effet par la pitié et la crainte jointes ensemble; mais, comme je l’ai déjà dit, il n’arrive pas toujours que ceux que nous plaignons soient malheureux par leur faute. Quand ils sont innocents, la pitié que nous en prenons ne produit aucune crainte, et si nous en concevons quelqu’une qui purge nos passions, c’est par le moyen d’une autre personne que de celle qui nous fait pitié, et nous la devons toute à la force de l’exemple. Cette explication se trouvera autorisée par Aristote même, si nous voulons bien peser la raison qu’il rend de l’exclusion de ces événements qu’il désapprouve dans la tragédie. Il ne dit jamais: Celui-là n’y est pas propre, parce qu’il n’excite que de la pitié et ne fait point naître de crainte, et cet autre n’y est pas supportable, parce qu’il n’excite que de la crainte et ne fait point naître de pitié; mais il les rebute, parce, dit-il, qu’ils n’excitent ni pitié ni crainte, et nous donne à connaître par là que c’est par le manque de l’une et de l’autre qu’ils ne lui plaisent pas, et que s’ils produisaient l’une des deux, il ne leur refuserait point son suffrage. L’exemple d’Oedipe qu’il allègue me confirme dans cette pensée. Si nous en croyons, il a toutes les conditions requises en la tragédie; néanmoins son malheur n’excite que de la pitié, et je ne pense pas qu’à le voir représenter, aucun de ceux qui le plaignent s’avise de craindre de tuer son père ou d’épouser sa mère. Si sa représentation nous peut imprimer quelque crainte, et que cette crainte soit capable de purger en nous quelque inclination blâmable ou vicieuse, elle y purgera la curiosité de savoir l’avenir, et nous empêchera d’avoir recours à des prédictions, qui ne servent d’ordinaire qu’à nous faire choir dans le malheur qu’on nous prédit par les soins mêmes que nous prenons de l’éviter; puisqu’il est certain qu’il n’eût jamais tué son père, ni épousé sa mère, si son père et sa mère, à qui l’oracle avait prédit que cela arriverait, ne l’eussent fait exposer de peur qu’il n’arrivât. Ainsi non seulement ce seront Laïus et Jocaste qui feront naître cette crainte, mais elle ne naîtra que de l’image d’une faute qu’ils ont faite quarante ans avant l’action qu’on représente, et ne s’exprimera en nous que par un autre acteur que le premier, et par une action hors de la tragédie. Pour recueillir ce discours, avant que de passer à une autre matière, établissons pour maxime que la perfection de la tragédie consiste bien à exciter de la pitié et de la crainte par le moyen d’un premier acteur, comme peut faire Rodrigue dans le Cid, et Placide dans Théodore, mais que cela n’est pas d’une nécessité si absolue qu’on ne se puisse servir de divers personnages pour faire naître ces deux sentiments, comme dans Rodogune; et même ne porter l’auditeur qu’à l’un des deux, comme dans Polyeucte, dont la représentation n’imprime que de la pitié sans aucune crainte. Cela posé, trouvons quelque modération à la rigueur de ces règles du philosophe, ou du moins quelque favorable interprétation, pour n’être pas obligés de condamner beaucoup de poèmes que nous avons vu réussir sur nos théâtres. Il ne veut point qu’un homme tout à fait innocent tombe dans l’infortune, parce que, cela étant abominable, il excite plus d’indignation contre celui qui le persécute que de pitié pour son malheur; il ne veut pas non plus qu’un très méchant y tombe, parce qu’il ne peut donner de pitié par un malheur qu’il mérite, ni en faire craindre un pareil à des spectateurs qui ne lui ressemblent pas; mais quand ces deux raisons cessent, en sorte qu’un homme de bien qui souffre excite plus de pitié pour lui que d’indignation contre celui qui le fait souffrir, ou que la punition d’un grand crime peut corriger en nous quelque imperfection qui a du rapport avec lui, j’estime qu’il ne faut point faire de difficulté d’exposer sur la scène des hommes très vertueux ou très méchants dans le malheur. En voici deux ou trois manières, que peut-être Aristote n’a su prévoir, parce qu’on n’en voyait pas d’exemples sur les théâtres de son temps. La première est, quand un homme très vertueux est persécuté par un très méchant, et qu’il échappe du péril où le méchant demeure enveloppé, comme dans Rodogune et dans Héraclius, qu’on n’aurait pu souffrir si Antiochus et Rodogune eussent péri dans la première, et Héraclius, Pulchérie et Martian dans l’autre, et que Cléopâtre et Phocas y eussent triomphé. Leur malheur y donne une pitié qui n’est point étouffée par l’aversion qu’on a pour ceux qui les tyrannisent, parce qu’on espère toujours que quelque heureuse révolution les empêchera de succomber; et bien que les crimes de Phocas et de Cléopâtre soient trop grands pour faire craindre l’auditeur d’en commettre de pareils, leur funeste issue peut faire sur lui les effets dont j’ai déjà parlé. Il peut arriver d’ailleurs qu’un homme très vertueux soit persécuté, et périsse même par les ordres d’un autre, qui ne soit pas assez méchant pour attirer trop d’indignation sur lui, et qui montre plus de faiblesse que de crime dans la persécution qu’il lui fait. Si Félix fait périr son gendre Polyeucte, ce n’est pas par cette haine enragée contre les chrétiens, qui nous le rendrait exécrable, mais seulement par une lâche timidité, qui n’ose le sauver en présence de Sévère, dont il craint la haine et la vengeance après les mépris qu’il en a faits durant son peu de fortune. On prend bien quelque aversion pour lui, on désapprouve sa manière d’agir; mais cette aversion ne l’emporte pas sur la pitié qu’on a de Polyeucte, et n’empêche pas que sa conversion miraculeuse, à la fin de la pièce, ne le réconcilie pleinement avec l’auditoire. On peut dire la même chose de Prusias dans Nicomède, et de Valens dans Théodore. L’un maltraite son fils, bien que très vertueux, et l’autre est cause de la perte du sien, qui ne l’est pas moins; mais tous les deux n’ont que des faiblesses qui ne vont point jusques au crime, et loin d’exciter une indignation qui étouffe la pitié qu’on a pour ces fils généreux, la lâcheté de leur abaissement sous des puissances qu’ils redoutent, et qu’ils devraient braver pour bien agir, fait qu’on a quelque compassion d’eux-mêmes et de leur honteuse politique. Pour nous faciliter les moyens d’exciter cette pitié, qui fait de si beaux effets sur nos théâtres, Aristote nous donne une lumière. Toute action, dit-il, se passe, ou entre des amis, ou entre des ennemis, ou entre des gens indifférents l’un pour l’autre. Qu’un ennemi tue ou veuille tuer son ennemi, cela ne produit aucune commisération, sinon en tant qu’on s’émeut d’apprendre ou de voir la mort d’un homme, quel qu’il soit. Qu’un indifférent tue un indifférent, cela ne touche guère davantage, d’autant qu’il n’excite aucun combat dans l’âme de celui qui fait l’action; mais quand les choses arrivent entre des gens que la naissance ou l’affection attache aux intérêts l’un de l’autre, comme alors qu’un mari tue ou est prêt de tuer sa femme, une mère ses enfants, un frère sa soeur; c’est ce qui convient merveilleusement à la tragédie. La raison en est claire. Les oppositions des sentiments de la nature aux emportements de la passion, ou à la sévérité du devoir, forment de puissantes agitations, qui sont reçues de l’auditeur avec plaisir; et il se porte aisément à plaindre un malheureux opprimé ou poursuivi par une personne qui devrait s’intéresser à sa conservation, et qui quelquefois ne poursuit sa perte qu’avec déplaisir, ou du moins avec répugnance. Horace et Curiace ne seraient point à plaindre, s’ils n’étaient point amis et beaux-frères; ni Rodrigue, s’il était poursuivi par un autre que par sa maîtresse; et le malheur d’Antiochus toucherait beaucoup moins, si un autre que sa mère lui demandait le sang de sa maîtresse, ou qu’un autre que sa maîtresse lui demandât celui de sa mère; ou si, après la mort de son frère, qui lui donne sujet de craindre un pareil attentat sur sa personne, il avait à se défier d’autres que de sa mère et de sa maîtresse. C’est donc un grand avantage, pour exciter la commisération, que la proximité du sang et les liaisons d’amour ou d’amitié entre le persécutant et le persécuté, le poursuivant et le poursuivi, celui qui fait souffrir et celui qui souffre; mais il y a quelque apparence que cette condition n’est pas d’une nécessité plus absolue que celle dont je viens de parler, et qu’elle ne regarde que les tragédies parfaites, non plus que celle-là. Du moins les anciens ne l’ont pas toujours observée: je ne la vois point dans l’Ajax de Sophocle, ni dans son Philoctète; et qui voudra parcourir ce qui nous reste d’Eschyle et d’Euripide y pourra rencontrer quelques exemples à joindre à ceux-ci. Quand je dis que ces deux conditions ne sont que pour les tragédies parfaites, je n’entends pas dire que celles où elles ne se rencontrent point soient imparfaites: ce serait les rendre d’une nécessité absolue, et me contredire moi-même. Mais par ce mot de tragédies parfaites j’entends celles du genre le plus sublime et le plus touchant, en sorte que celles qui manquent de l’une de ces deux conditions, ou de toutes les deux, pourvu qu’elles soient régulières à cela près, ne laissent pas d’être parfaites en leur genre, bien qu’elles demeurent dans un rang moins élevé, et n’approchent pas de la beauté et de l’éclat des autres, si elles n’en empruntent de la pompe des vers, ou de la magnificence du spectacle, ou de quelque autre agrément qui vienne d’ailleurs que du sujet. Dans ces actions tragiques qui se passent entre proches, il faut considérer si celui qui veut faire périr l’autre le connaît ou ne le connaît pas, et s’il achève, ou n’achève pas. La diverse combination de ces deux manières d’agir forme quatre sortes de tragédies, à qui notre philosophe attribue divers degrés de perfection. On connaît celui qu’on veut perdre, et on le fait périr en effet, comme Médée tue ses enfants, Clytemnestre son mari, Oreste sa mère; et la moindre espèce est celle-là. On le fait périr sans le connaître, et on le reconnaît avec déplaisir après l’avoir perdu; et cela, dit-il, ou avant la tragédie, comme Oedipe, ou dans la tragédie, comme l’Alcméon d’Astydamas, et Télégonus dans Ulysse blessé, qui sont deux pièces que le temps n’a pas laissé venir jusqu’à nous; et cette seconde espèce a quelque chose de plus élevé, selon lui, que la première. La troisième est dans le haut degré d’excellence, quand on est prêt de faire périr un de ses proches sans le connaître, et qu’on le reconnaît assez tôt pour le sauver, comme Iphigénie reconnaît Oreste pour son frère, lorsqu’elle devait le sacrifier à Diane, et s’enfuit avec lui. Il en cite encore deux autres exemples, de Mérope dans Cresphonte, et de Hellé, dont nous ne connaissons ni l’un ni l’autre. Il condamne entièrement la quatrième espèce de ceux qui connaissent, entreprennent et n’achèvent pas, qu’il dit avoir quelque chose de méchant, et rien de tragique, et en donne pour exemple Hémon qui tire l’épée contre son père dans l’Antigone, et ne s’en sert que pour se tuer lui-même. Mais si cette condamnation n’était modifiée, elle s’étendrait un peu loin, et envelopperait non seulement le Cid, mais Cinna, Rodogune, Héraclius et Nicomède. Disons donc qu’elle ne doit s’entendre que de ceux qui connaissent la personne qu’ils veulent perdre, et s’en dédisent par un simple changement de volonté, sans aucun événement notable qui les y oblige, et sans aucun manque de pouvoir de leur part. J’ai déjà marqué cette sorte de dénouement pour vicieux; mais quand ils y font de leur côté tout ce qu’ils peuvent, et qu’ils sont empêchés d’en venir à l’effet par quelque puissance supérieure, ou par quelque changement de fortune qui les fait périr eux-mêmes, ou les réduit sous le pouvoir de ceux qu’ils voulaient perdre, il est hors de doute que cela fait une tragédie d’un genre peut-être plus sublime que les trois qu’Aristote avoue; et que s’il n’en a point parlé, c’est qu’il n’en voyait point d’exemples sur les théâtres de son temps, où ce n’était pas la mode de sauver les bons par la perte des méchants, à moins que de les souiller eux-mêmes de quelque crime, comme Electre, qui se délivre d’oppression par la mort de sa mère, où elle encourage son frère, et lui en facilite les moyens. L’action de Chimène n’est donc pas défectueuse pour ne perdre pas Rodrigue après l’avoir entrepris, puisqu’elle y fait son possible, et que tout ce qu’elle peut obtenir de la justice de son roi, c’est un combat où la victoire de ce déplorable amant lui impose silence. Cinna et son Emilie ne pèchent point contre la règle en ne perdant point Auguste, puisque la conspiration découverte les en met dans l’impuissance, et qu’il faudrait qu’ils n’eussent aucune teinture d’humanité, si une clémence si peu attendue ne dissipait toute leur haine. Qu’épargne Cléopâtre pour perdre Rodogune? Qu’oublie Phocas pour se défaire d’Héraclius? Et si Prusias demeurait le maître, Nicomède n’irait-il pas servir d’otage à Rome, ce qui lui serait un plus rude supplice que la mort? Les deux premiers reçoivent la peine de leurs crimes, et succombent dans leurs entreprises sans s’en dédire; et ce dernier est forcé de reconnaître son injustice après que le soulèvement de son peuple, et la générosité de ce fils qu’il voulait agrandir aux dépens de son aîné, ne lui permettent plus de la faire réussir. Ce n’est pas démentir Aristote que de l’expliquer ainsi favorablement, pour trouver dans cette quatrième manière d’agir qu’il rebute, une espèce de nouvelle tragédie plus belle que les trois qu’il recommande, et qu’il leur eût sans doute préférée, s’il l’eût connue. C’est faire honneur à notre siècle, sans rien retrancher de l’autorité de ce philosophe; mais je ne sais comment faire pour lui conserver cette autorité, et renverser l’ordre de la préférence qu’il établit entre ces trois espèces. Cependant je pense être bien fondé sur l’expérience à douter si celle qu’il estime la moindre des trois n’est point la plus belle, et si celle qu’il tient la plus belle n’est point la moindre. La raison est que celle-ci ne peut exciter de pitié. Un père y veut perdre son fils sans le connaître, et ne le regarde que comme indifférent, et peut-être comme ennemi. Soit qu’il passe pour l’un ou pour l’autre, son péril n’est digne d’aucune commisération, selon Aristote même, et ne fait naître en l’auditeur qu’un certain mouvement de trépidation intérieure, qui le porte à craindre que ce fils ne périsse avant que l’erreur soit découverte, et à souhaiter qu’elle se découvre assez tôt pour l’empêcher de périr: ce qui part de l’intérêt qu’on ne manque jamais à prendre dans la fortune d’un homme assez vertueux pour se faire aimer; et quand cette reconnaissance arrive, elle ne produit qu’un sentiment de conjouissance, de voir arriver la chose comme on le souhaitait. Quand elle ne se fait qu’après la mort de l’inconnu, la compassion qu’excitent les déplaisirs de celui qui le fait périr ne peut avoir grande étendue, puisqu’elle est reculée et renfermée dans la catastrophe; mais lorsqu’on agit à visage découvert, et qu’on sait à qui on en veut, le combat des passions contre la nature, ou du devoir contre l’amour, occupe la meilleure partie du poème; et de là naissent les grandes et fortes émotions qui renouvellent à tous moments et redoublent la commisération. Pour justifier ce raisonnement par l’expérience, nous voyons que Chimène et Antiochus en excitent beaucoup plus que ne fait Oedipe de sa personne. Je dis de sa personne, parce que le poème entier en excite peut-être autant que le Cid ou que Rodogune; mais il en doit une partie à Dircé, et ce qu’elle en fait naître n’est qu’une pitié empruntée d’un épisode. Je sais que l’agnition est un grand ornement dans les tragédies: Aristote le dit; mais il est certain qu’elle a ses incommodités. Les Italiens l’affectent en la plupart de leurs poèmes, et perdent quelquefois, par l’attachement qu’ils y ont, beaucoup d’occasions de sentiments pathétiques qui auraient des beautés plus considérables. Cela se voit manifestement en la Mort de Crispe, faite par un de leurs plus beaux esprits, Jean-Baptiste Ghirardelli, et imprimée à Rome en l’année 1653. Il n’a pas manqué d’y cacher sa naissance à Constantin, et d’en faire seulement un grand capitaine, qu’il ne reconnaît pour son fils qu’après qu’il l’a fait mourir. Toute cette pièce est si pleine d’esprit et de beaux sentiments, qu’elle eut assez d’éclat pour obliger à écrire contre son auteur, et à la censurer sitôt qu’elle parut. Mais combien cette naissance cachée sans besoin, et contre la vérité d’une histoire connue, lui a-t-elle dérobé de choses plus belles que les brillants dont il a semé cet ouvrage! Les ressentiments, le trouble, l’irrésolution et les déplaisirs de Constantin auraient été bien autres à prononcer un arrêt de mort contre son fils que contre un soldat de fortune. L’injustice de sa préoccupation aurait été bien plus sensible à Crispe de la part d’un père que de la part d’un maître; et la qualité de fils, augmentant la grandeur du crime qu’on lui imposait, eût en même temps augmenté la douleur d’en voir un père persuadé. Fauste même aurait eu plus de combats intérieurs pour entreprendre un inceste que pour se résoudre à un adultère; ses remords en auraient été plus animés, et ses désespoirs plus violents. L’auteur a renoncé à tous ces avantages pour avoir dédaigné de traiter ce sujet comme l’a traité de notre temps le P. Stéphonius, jésuite, et comme nos anciens ont traité celui d’Hippolyte; et pour avoir cru l’élever d’un étage plus haut selon la pensée d’Aristote, je ne sais s’il ne l’a point fait tomber au-dessous de ceux que je viens de nommer. Il y a grande apparence que ce qu’a dit ce philosophe de ces divers degrés de perfection pour la tragédie avait une entière justesse de son temps, et en la présence de ses compatriotes; je n’en veux point douter; mais aussi je ne puis empêcher de dire que le goût de notre siècle n’est point celui du sien sur cette préférence d’une espèce à l’autre, ou du moins que ce qui plaisait au dernier point à ses Athéniens ne plaît pas également à nos Français; et je ne sais point d’autre moyen de trouver mes doutes supportables, et demeurer tout ensemble dans la vénération que nous devons à tout ce qu’il a écrit de la poétique. Avant que de quitter cette matière, examinons son sentiment sur deux questions touchant ces sujets entre des personnes proches: l’une, si le poète les peut inventer; l’autre, s’il ne peut rien changer en ceux qu’il tire de l’histoire ou de la fable. Pour la première, il est indubitable que les anciens en prenaient si peu de liberté, qu’ils arrêtaient leurs tragédies autour de peu de familles, parce que ces sortes d’actions étaient arrivées en peu de familles; ce qui fait dire à ce philosophe que la fortune leur fournissait des sujets, et non pas l’art. Je pense l’avoir dit en l’autre discours. Il semble toutefois qu’il en accorde un plein pouvoir aux poètes par ces paroles: Ils doivent bien user de ce qui est reçu, ou inventer eux-mêmes. Ces termes décideraient la question, s’ils n’étaient point si généraux; mais comme il a posé trois espèces de tragédies, selon les divers temps de connaître et les diverses façons d’agir, nous pouvons faire une revue sur toutes les trois, pour juger s’il n’est point à propos d’y faire quelque distinction qui resserre cette liberté. J’en dirai mon avis d’autant plus hardiment, qu’on ne pourra m’imputer de contredire Aristote, pourvu que je la laisse entière à quelqu’une des trois. J’estime donc, en premier lieu, qu’en celles où l’on se propose de faire périr quelqu’un que l’on connaît, soit qu’on achève, soit qu’on soit empêché d’achever, il n’y a aucune liberté d’inventer la principale action, mais qu’elle doit être tirée de l’histoire ou de la fable. Ces entreprises contre des proches ont toujours quelque chose de si criminel et de si contraire à la nature, qu’elles ne sont pas croyables, à moins que d’être appuyées sur l’une ou sur l’autre; et jamais elles n’ont cette vraisemblance sans laquelle ce qu’on invente ne peut être de mise. Je n’ose décider si absolument de la seconde espèce. Qu’un homme prenne querelle avec un autre, et que l’ayant tué il vienne à le reconnaître pour son père ou pour son frère, et en tombe au désespoir, cela n’a rien que de vraisemblable, et par conséquent on le peut inventer; mais d’ailleurs cette circonstance de tuer son père ou son frère sans le connaître, est si extraordinaire et si éclatante, qu’on a quelque droit de dire que l’histoire n’ose manquer à s’en souvenir, quand elle arrive entre des personnes illustres, et de refuser toute croyance à de tels événements, quand elle ne les marque point. Le théâtre ancien ne nous en fournit aucun exemple qu’Oedipe; et je ne me souviens point d’en avoir vu aucun autre chez nos historiens. Je sais que cet événement sent plus la fable que l’histoire, et que par conséquent il peut avoir été inventé, ou en tout, ou en partie; mais la fable et l’histoire de l’antiquité sont si mêlées ensemble, que pour n’être pas en péril d’en faire un faux discernement, nous leur donnons une égale autorité sur nos théâtres. Il suffit que nous n’inventions pas ce qui de soi n’est point vraisemblable, et qu’étant inventé de longue main, il soit devenu si bien de la connaissance de l’auditeur, qu’il ne s’effarouche point à le voir sur la scène. Toute la Métamorphose d’Ovide est manifestement d’invention; on peut en tirer des sujets de tragédie, mais non pas inventer sur ce modèle, si ce n’est des épisodes de même trempe: la raison en est que bien que nous ne devions rien inventer que de vraisemblable, et que ces sujets fabuleux, comme Andromède et Phaéton, ne le soient point du tout, inventer des épisodes, ce n’est pas tant inventer qu’ajouter à ce qui est déjà inventé; et ces épisodes trouvent une espèce de vraisemblance dans leur rapport avec l’action principale; en sorte qu’on peut dire que supposé que cela se soit pu faire, il s’est pu faire comme le poète le décrit. De tels épisodes toutefois ne seraient pas propres à un sujet historique ou de pure invention, parce qu’ils manqueraient de rapport avec l’action principale, et seraient moins vraisemblables qu’elle. Les apparitions de Vénus et d’Eole ont eu bonne grâce dans Andromède; mais si j’avais fait descendre Jupiter pour réconcilier Nicomède avec son père, ou Mercure pour révéler à Auguste la conspiration de Cinna, j’aurais fait révolter tout mon auditoire, et cette merveille aurait détruit toute la croyance que le reste de l’action aurait obtenue. Ces dénouements par des Dieux de machine sont fort fréquents chez les Grecs, dans des tragédies qui paraissent historiques, et qui sont vraisemblables à cela près: aussi Aristote ne les condamne pas tout à fait, et se contente de leur préférer ceux qui viennent du sujet. Je ne sais ce qu’en décidaient les Athéniens, qui étaient leurs juges; mais les deux exemples que je viens de citer montrent suffisamment qu’il serait dangereux pour nous de les imiter en cette sorte de licence. On me dira que ces apparitions n’ont garde de nous plaire, parce que nous en savons manifestement la fausseté, et qu’elles choquent notre religion, ce qui n’arrivait pas chez les Grecs. J’avoue qu’il faut s’accommoder aux moeurs de l’auditeur et à plus forte raison à sa croyance; mais aussi doit-on m’accorder que nous avons du moins autant de foi pour l’apparition des anges et des saints que les anciens en avaient pour celle de leur Apollon et de leur Mercure: cependant qu’aurait-on dit, si pour démêler Héraclius d’avec Martian, après la mort de Phocas, je me fusse servi d’un ange? Ce poème est entre des chrétiens, et cette apparition y aurait eu autant de justesse que celle des Dieux de l’antiquité dans ceux des Grecs; c’eût été néanmoins un secret infaillible de rendre celui-là ridicule, et il ne faut qu’avoir un peu de sens commun pour en demeurer d’accord. Qu’on me permette donc de dire avec Tacite: Non omnia apud priores meliora, sed nostra quoque oetas multa laudis et artium imitanda posteris tulit. Je reviens aux tragédies de cette seconde espèce, où l’on ne connaît un père ou un fils qu’après l’avoir fait périr; et pour conclure en deux mots après cette digression, je ne condamnerai jamais personne pour en avoir inventé; mais je ne me le permettrai jamais. Celles de la troisième espèce ne reçoivent aucune difficulté: non seulement on les peut inventer, puisque tout y est vraisemblable et suit le train commun des affections naturelles, mais je doute même si ce ne serait point les bannir du théâtre que d’obliger les poètes à en prendre les sujets dans l’histoire. Nous n’en voyons point de cette nature chez les Grecs, qui n’aient la mine d’avoir été inventés par leurs auteurs. Il se peut faire que la fable leur en ait prêté quelques-uns. Je n’ai pas les yeux assez pénétrants pour percer de si épaisses obscurités, et déterminer si l’Iphigénie in Tauris est de l’invention d’Euripide, comme son Hélène et son Ion, ou s’il l’a prise d’un autre; mais je crois pouvoir dire qu’il est très malaisé d’en trouver dans l’histoire, soit que tels événements n’arrivent que très rarement, soit qu’ils n’aient pas assez d’éclat pour y mériter une place: celui de Thésée, reconnu par le roi d’Athènes, son père, sur le point qu’il l’allait faire périr, est le seul dont il me souvienne. Quoi qu’il en soit, ceux qui aiment à les mettre sur la scène peuvent les inventer sans crainte de la censure: ils pourront produire par là quelque agréable suspension dans l’esprit de l’auditeur; mais il ne faut pas qu’ils se promettent de lui tirer beaucoup de larmes. L’autre question, s’il est permis de changer quelque chose aux sujets qu’on emprunte de l’histoire ou de la fable, semble décidée en termes assez formels par Aristote, lorsqu’il dit qu’il ne faut point changer les sujets reçus, et que Clytemnestre ne doit point être tuée par un autre qu’Oreste, ni Eriphyle par un autre qu’Alcméon. Cette décision peut toutefois recevoir quelque distinction et quelque tempérament. Il est constant que les circonstances, ou si vous l’aimez mieux, les moyens de parvenir à l’action, demeurent en notre pouvoir. L’histoire souvent ne les marque pas, ou en rapporte si peu, qu’il est besoin d’y suppléer pour remplir le poème; et même il y a quelque apparence de présumer que la mémoire de l’auditeur, qui les aura lues autrefois, ne s’y sera pas si fort attachée qu’il s’aperçoive assez du changement que nous y aurons fait, pour nous accuser de mensonge; ce qu’il ne manquerait pas de faire s’il voyait que nous changeassions l’action principale. Cette falsification serait cause qu’il n’ajouterait aucune foi à tout le reste; comme au contraire il croit aisément tout ce reste quand il le voit servir d’acheminement à l’effet qu’il sait véritable, et dont l’histoire lui a laissé une plus forte impression. L’exemple de la mort de Clytemnestre peut servir de preuve à ce que je viens d’avancer: Sophocle et Euripide l’ont traitée tous deux, mais chacun avec un noeud et un dénouement tout à fait différents l’un de l’autre; et c’est cette différence qui empêche que ce ne soit la même pièce, bien que ce soit le même sujet, dont ils ont conservé l’action principale. Il faut donc la conserver comme eux; mais il faut examiner en même temps si elle n’est point si cruelle, ou si difficile à représenter, qu’elle puisse diminuer quelque chose de la croyance que l’auditeur doit à l’histoire, et qu’il veut bien donner à la fable, en se mettant en la place de ceux qui l’ont prise pour une vérité. Lorsque cet inconvénient est à craindre, il est bon de cacher l’événement à la vue, et de le faire savoir par un récit qui frappe moins que le spectacle, et nous impose plus aisément. C’est par cette raison qu’Horace ne veut pas que Médée tue ses enfants, ni qu’Atrée fasse rôtir ceux de Thyeste à la vue du peuple. L’horreur de ces actions engendre une répugnance à les croire, aussi bien que la métamorphose de Progné en oiseau et de Cadmus en serpent, dont la représentation presque impossible excite la même incrédulité quand on la hasarde aux yeux du spectateur: Quaecumque ostendis mihi sic, incredulus odi. Je passe plus outre, et pour exténuer ou retrancher cette horreur dangereuse d’une action historique, je voudrais la faire arriver sans la participation du premier acteur, pour qui nous devons toujours ménager la faveur de l’auditoire. Après que Cléopâtre eut tué Séleucus, elle présenta du poison à son autre fils Antiochus, à son retour de la chasse; et ce prince, soupçonnant ce qu’il en était, la contraignit de le prendre, et la força à s’empoisonner. Si j’eusse fait voir cette action sans y rien changer, c’eût été punir un parricide par un autre parricide; on eût pris aversion pour Antiochus, et il a été bien plus doux de faire qu’elle-même, voyant que sa haine et sa noire perfidie allaient être découvertes, s’empoisonne dans son désespoir, à dessein d’envelopper ces deux amants dans sa perte, en leur ôtant tout sujet de défiance. Cela fait deux effets. La punition de cette impitoyable mère laisse un plus fort exemple, puisqu’elle devient un effet de la justice du ciel, et non pas de la vengeance des hommes; d’autre côté, Antiochus ne perd rien de la compassion et de l’amitié qu’on avait pour lui, qui redoublent plutôt qu’elles ne diminuent; et enfin l’action historique s’y trouve conservée malgré ce changement, puisque Cléopâtre périt par le même poison qu’elle présente à Antiochus. Phocas était un tyran, et sa mort n’était pas un crime; cependant il a été sans doute plus à propos de la faire arriver par la main d’Exupère que par celle d’Héraclius. C’est un soin que nous devons prendre de préserver nos héros du crime tant qu’il se peut, et les exempter même de tremper leurs mains dans le sang, si ce n’est en un juste combat. J’ai beaucoup osé dans Nicomède: Prusias son père l’avait voulu faire assassiner dans son armée; sur l’avis qu’il en eut par les assassins mêmes, il entra dans son royaume, s’en empara, et réduisit ce malheureux père à se cacher dans une caverne, où il le fit assassiner lui-même. Je n’ai pas poussé l’histoire jusque-là; et après l’avoir peint trop vertueux pour l’engager dans un parricide, j’ai cru que je pouvais me contenter de le rendre maître de la vie de ceux qui le persécutaient, sans le faire passer plus avant. Je ne saurais dissimuler une délicatesse que j’ai sur la mort de Clytemnestre, qu’Aristote nous propose pour exemple des actions qui ne doivent point être changées. Je veux bien avec lui qu’elle ne meure que de la main de son fils Oreste; mais je ne puis souffrir chez Sophocle que ce fils la poignarde de dessein formé cependant qu’elle est à genoux devant lui et le conjure de lui laisser la vie. Je ne puis même pardonner à Electre, qui passe pour une vertueuse opprimée dans le reste de la pièce, l’inhumanité dont elle encourage son frère à ce parricide. C’est un fils qui venge son père, mais c’est sur sa mère qu’il le venge. Séleucus et Antiochus avaient droit d’en faire autant dans Rodogune; mais je n’ai osé leur en donner la moindre pensée. Aussi notre maxime de faire aimer nos principaux acteurs n’était pas de l’usage des anciens, et ces républicains avaient une si forte haine des rois, qu’ils voyaient avec plaisir des crimes dans les plus innocents de leur race. Pour rectifier ce sujet à notre mode, il faudrait qu’Oreste n’eût dessein que contre Egisthe; qu’un reste de tendresse respectueuse pour sa mère lui en fît remettre la punition aux Dieux; que cette reine s’opiniâtrât à la protection de son adultère, et qu’elle se mît entre son fils et lui si malheureusement qu’elle reçût le coup que ce prince voudrait porter à cet assassin de son père. Ainsi elle mourrait de la main de son fils, comme le veut Aristote, sans que la barbarie d’Oreste nous fît horreur, comme dans Sophocle, ni que son action méritât des Furies vengeresses pour le tourmenter, puisqu’il demeurerait innocent. Le même Aristote nous autorise à eu user de cette manière, lorsqu’il nous apprend que le poète n’est pas obligé de traiter les choses comme elles se sont passées, mais comme elles ont pu ou dû se passer, selon le vraisemblable ou le nécessaire. Il répète souvent ces derniers mots, et ne les explique jamais. Je tâcherai d’y suppléer au moins mal qu’il me sera possible, et j’espère qu’on me pardonnera si je m’abuse. Je dis donc premièrement que cette liberté qu’il nous laisse d’embellir les actions historiques par des inventions vraisemblables n’emporte aucune défense de nous écarter du vraisemblable dans le besoin. C’est un privilège qu’il nous donne, et non pas une servitude qu’il nous impose: cela est clair par ses paroles mêmes. Si nous pouvons traiter les choses selon le vraisemblable ou selon le nécessaire, nous pouvons quitter le vraisemblable pour suivre le nécessaire; et cette alternative met en notre choix de nous servir de celui des deux que nous jugerons le plus à propos. Cette liberté du poète se trouve encore en termes plus formels dans le vingt et cinquième chapitre, qui contient les excuses ou plutôt les justifications dont il se peut servir contre la censure: Il faut, dit-il, qu’il suive un de ces trois moyens de traiter les choses, et qu’il les représente ou comme elles ont été, ou comme on dit qu’elles ont été, ou comme elles ont dû être: par où il lui donne le choix, ou de la vérité historique, ou de l’opinion commune sur quoi la fable est fondée, ou de la vraisemblance. Il ajoute ensuite: Si on le reprend de ce qu’il n’a pas écrit les choses dans la vérité, qu’il réponde qu’il les a écrites comme elles ont dû être; si on lui impute de n’avoir fait ni l’un ni l’autre, qu’il se défende sur ce qu’en publie l’opinion commune comme en ce qu’on raconte des Dieux, dont la plus grande partie n’a rien de véritable. Et un peu plus bas: Quelquefois ce n’est pas le meilleur qu’elles se soient passées de la manière qu’il décrit; néanmoins elles se sont passées effectivement de cette manière, et par conséquent il est hors de faute. Ce dernier passage montre que nous ne sommes point obligés de nous écarter de la vérité pour donner une meilleure forme aux actions de la tragédie par les ornements de la vraisemblance, et le montre d’autant plus fortement, qu’il demeure pour constant, par le second de ces trois passages, que l’opinion commune suffit pour nous justifier quand nous n’avons pas pour nous la vérité, et que nous pourrions faire quelque chose de mieux que ce que nous faisons, si nous recherchions les beautés de cette vraisemblance. Nous courons par là quelque risque d’un plus faible succès; mais nous ne péchons que contre le soin que nous devons avoir de notre gloire, et non pas contre les règles du théâtre. Je fais une seconde remarque sur ces termes de vraisemblable et de nécessaire, dont l’ordre se trouve quelquefois renversé chez ce philosophe, qui tantôt dit, selon le nécessaire ou le vraisemblable, et tantôt selon le vraisemblable ou le nécessaire. D’où je tire une conséquence, qu’il y a des occasions où il faut préférer le vraisemblable au nécessaire, et d’autres où il faut préférer le nécessaire au vraisemblable. La raison en est que ce qu’on emploie le dernier dans les propositions alternatives y est placé comme un pis aller, dont il faut se contenter quand on ne peut arriver à l’autre, et qu’on doit faire effort pour le premier avant que de se réduire au second, où l’on n’a droit de recourir qu’au défaut de ce premier. Pour éclaircir cette préférence mutuelle du vraisemblable au nécessaire, et du nécessaire au vraisemblable, il faut distinguer deux choses dans les actions qui composent la tragédie. La première consiste en ces actions mêmes, accompagnées des inséparables circonstances du temps et du lieu; et l’autre en la liaison qu’elles ont ensemble, qui les fait naître l’une de l’autre. En la première, le vraisemblable est à préférer au nécessaire; et le nécessaire au vraisemblable, dans la seconde. Il faut placer les actions où il est plus facile et mieux séant qu’elles arrivent, et les faire arriver dans un loisir raisonnable, sans les presser extraordinairement, si la nécessité de les renfermer dans un lieu et dans un jour ne nous y oblige. J’ai déjà fait voir en l’autre Discours que pour conserver l’unité de lieu, nous faisons parler souvent des personnes dans une place publique, qui vraisemblablement s’entretiendraient dans une chambre; et je m’assure que si on racontait dans un roman ce que je fais arriver dans le Cid, dans Polyeucte, dans Pompée, ou dans le Menteur, on lui donnerait un peu plus d’un jour pour l’étendue de sa durée. L’obéissance que nous devons aux règles de l’unité de jour et de lieu nous dispense alors du vraisemblable, bien qu’elle ne nous permette pas l’impossible; mais nous ne tombons pas toujours dans cette nécessité; et la Suivante, Cinna, Théodore, et Nicomède, n’ont point eu besoin de s’écarter de la vraisemblance à l’égard du temps, comme ces autres poèmes. Cette réduction de la tragédie au roman est la pierre de touche pour démêler les actions nécessaires d’avec les vraisemblables. Nous sommes gênés au théâtre par le lieu, par le temps, et par les incommodités de la représentation, qui nous empêchent d’exposer à la vue beaucoup de personnages tout à la fois, de peur que les uns ne demeurent sans action, ou troublent celle des autres. Le roman n’a aucune de ces contraintes: il donne aux actions qu’il décrit tout le loisir qu’il leur faut pour arriver; il place ceux qu’il fait parler, agir ou rêver, dans une chambre, dans une forêt, en place publique, selon qu’il est plus à propos pour leur action particulière; il a pour cela tout un palais, toute une ville, tout un royaume, toute la terre, où les promener; et s’il fait arriver ou raconter quelque chose en présence de trente personnes, il en peut décrire les divers sentiments l’un après l’autre. C’est pourquoi il n’a jamais aucune liberté de se départir de la vraisemblance, parce qu’il n’a jamais aucune raison ni excuse légitime pour s’en écarter. Comme le théâtre ne nous laisse pas tant de facilité de réduire tout dans le vraisemblable, parce qu’il ne nous fait rien savoir que par des gens qu’il expose à la vue de l’auditeur en peu de temps, il nous en dispense aussi plus aisément. On peut soutenir que ce n’est pas tant nous en dispenser, que nous permettre une vraisemblance plus large; mais puisque Aristote nous autorise à y traiter les choses selon le nécessaire, j’aime mieux dire que tout ce qui s’y passe d’une autre façon qu’il ne se passerait dans un roman n’a point de vraisemblance, à le bien prendre, et se doit ranger entre les actions nécessaires. L’Horace en peut fournir quelques exemples: l’unité de lieu y est exacte, tout s’y passe dans une salle. Mais si on en faisait un roman avec les mêmes particularités de scène en scène que j’y ai employées, ferait-on tout passer dans cette salle? A la fin du premier acte, Curiace et Camille sa maîtresse vont rejoindre le reste de la famille, qui doit être dans un autre appartement; entre les deux actes, ils y reçoivent la nouvelle de l’élection des trois Horaces; à l’ouverture du second, Curiace paraît dans cette même salle pour l’en congratuler. Dans le roman, il aurait fait cette congratulation au même lieu où l’on en reçoit la nouvelle, en présence de toute la famille, et il n’est point vraisemblable qu’ils s’écartent eux deux pour cette conjouissance; mais il est nécessaire pour le théâtre; et à moins que cela, les sentiments des trois Horaces, de leur père, de leur soeur, de Curiace, et de Sabine, se fussent présentés à faire paraître tous à la fois. Le roman, qui ne fait rien voir, en fût aisément venu à bout; mais sur la scène il a fallu les séparer, pour y mettre quelque ordre, et les prendre l’un après l’autre, en commençant par ces deux-ci, que j’ai été forcé de ramener dans cette salle sans vraisemblance. Cela passé, le reste de l’acte est tout à fait vraisemblable, et n’a rien qu’on fût obligé de faire arriver d’une autre manière dans le roman. A la fin de cet acte, Sabine et Camille, outrées de déplaisir, se retirent de cette salle avec un emportement de douleur, qui vraisemblablement va renfermer leurs larmes dans leur chambre, où le roman les ferait demeurer et y recevoir la nouvelle du combat. Cependant, par la nécessité de les faire voir aux spectateurs, Sabine quitte sa chambre au commencement du troisième acte, et revient entretenir ses douloureuses inquiétudes dans cette salle, où Camille la vient trouver. Cela fait, le reste de cet acte est vraisemblable, comme en l’autre; et si vous voulez examiner avec cette rigueur les premières scènes des deux derniers, vous trouverez peut-être la même chose, et que le roman placerait ses personnages ailleurs qu’en cette salle, s’ils en étaient une fois sortis, comme ils en sortent à la fin de chaque acte. Ces exemples peuvent suffire pour expliquer comme on peut traiter une action selon le nécessaire, quand on ne la peut traiter selon le vraisemblable, qu’on doit toujours préférer au nécessaire lorsqu’on ne regarde que les actions en elles-mêmes. Il n’en va pas ainsi de leur liaison qui les fait naître l’une de l’autre: le nécessaire y est à préférer au vraisemblable, non que cette liaison ne doive toujours être vraisemblable, mais parce qu’elle est beaucoup meilleure quand elle est vraisemblable et nécessaire tout ensemble. La raison en est aisée à concevoir. Lorsqu’elle n’est que vraisemblable sans être nécessaire, le poème s’en peut passer, et elle n’y est pas de grande importance; mais quand elle est vraisemblable et nécessaire, elle devient une partie essentielle du poème, qui ne peut subsister sans elle. Vous trouverez dans Cinna des exemples de ces deux sortes de liaisons: j’appelle ainsi la manière dont une action est produite par l’autre. Sa conspiration contre Auguste est causée nécessairement par l’amour qu’il a pour Emilie, parce qu’il la veut épouser, et qu’elle ne veut se donner à lui qu’à cette condition. De ces deux actions, l’une est vraie, l’autre est vraisemblable, et leur liaison est nécessaire. La bonté d’Auguste donne des remords et de l’irrésolution à Cinna: ces remords et cette irrésolution ne sont causés que vraisemblablement par cette bonté, et n’ont qu’une liaison vraisemblable avec elle, parce que Cinna pouvait demeurer dans la fermeté, et arriver à son but, qui est d’épouser Emilie. Il la consulte dans cette irrésolution: cette consultation n’est que vraisemblable, mais elle est un effet nécessaire de son amour, parce que s’il eût rompu la conjuration sans son aveu, il ne fût jamais arrivé à ce but qu’il s’était proposé, et par conséquent voilà une liaison nécessaire entre deux actions vraisemblables, ou si vous l’aimez mieux, une production nécessaire d’une action vraisemblable par une autre pareillement vraisemblable. Avant que d’en venir aux définitions et divisions du vraisemblable et du nécessaire, je fais encore une réflexion sur les actions qui composent la tragédie, et trouve que nous pouvons y en faire entrer de trois sortes, selon que nous le jugeons à propos: les unes suivent l’histoire, les autres ajoutent à l’histoire, les troisièmes falsifient l’histoire. Les premières sont vraies, les secondes quelquefois vraisemblables et quelquefois nécessaires, et les dernières doivent toujours être nécessaires. Lorsqu’elles sont vraies, il ne faut point se mettre en peine de la vraisemblance, elles n’ont pas besoin de son secours. Tout ce qui s’est fait manifestement s’est pu faire, dit Aristote, parce que, s’il ne s’était pu faire, il ne se serait pas fait. Ce que nous ajoutons à l’histoire, comme il n’est pas appuyé de son autorité, n’a pas cette prérogative. Nous avons une pente naturelle, ajoute ce philosophe, à croire que ce qui ne s’est point fait n’a pu encore se faire; et c’est pourquoi ce que nous inventons a besoin de la vraisemblance la plus exacte qu’il est possible pour le rendre croyable. A bien peser ces deux passages, je crois ne m’éloigner point de sa pensée quand j’ose dire, pour définir le vraisemblable, que c’est une chose manifestement possible dans la bienséance, et qui n’est ni manifestement vraie ni manifestement fausse. On en peut faire deux divisions, l’une en vraisemblable général et particulier, l’autre en ordinaire et extraordinaire. Le vraisemblable général est ce que peut faire et qu’il est à propos que fasse un roi, un général d’armée, un amant, un ambitieux, etc. Le particulier est ce qu’a pu ou dû faire Alexandre, César, Alcibiade, compatible avec ce que l’histoire nous apprend de ses actions. Ainsi tout ce qui choque l’histoire sort de cette vraisemblance, parce qu’il est manifestement faux; et il n’est pas vraisemblable que César, après la bataille de Pharsale, se soit remis en bonne intelligence avec Pompée, ou Auguste avec Antoine après celle d’Actium, bien qu’à parler en termes généraux il soit vraisemblable que, dans une guerre civile, après une grande bataille, les chefs des partis contraires se réconcilient, principalement lorsqu’ils sont généreux l’un et l’autre. Cette fausseté manifeste, qui détruit la vraisemblance, se peut rencontrer même dans les pièces qui sont toutes d’invention. On n’y peut falsifier l’histoire, puisqu’elle n’y a aucune part; mais il y a des circonstances, des temps et des lieux qui peuvent convaincre un auteur de fausseté quand il prend mal ses mesures. Si j’introduisais un roi de France ou d’Espagne sous un nom imaginaire, et que je choisisse pour le temps de mon action un siècle dont l’histoire eût marqué les véritables rois de ces deux royaumes, la fausseté serait toute visible; et c’en serait une encore plus palpable si je plaçais Rome à deux lieues de Paris, afin qu’on pût y aller et revenir en un même jour. Il y a des choses sur qui le poète n’a jamais aucun droit. Il peut prendre quelque licence sur l’histoire, en tant qu’elle regarde les actions des particuliers, comme celle de César ou d’Auguste, et leur attribuer des actions qu’ils n’ont pas faites, ou les faire arriver d’une autre manière qu’ils ne les ont faites; mais il ne peut pas renverser la chronologie pour faire vivre Alexandre du temps de César, et moins encore changer la situation des lieux, ou les noms des royaumes, des provinces, des villes, des montagnes, et des fleuves remarquables. La raison est que ces provinces, ces montagnes, ces rivières, sont des choses permanentes. Ce que nous savons de leur situation était dès le commencement du monde; nous devons présumer qu’il n’y a point eu de changement, à moins que l’histoire le marque; et la géographie nous en apprend tous les noms anciens et modernes. Ainsi un homme serait ridicule d’imaginer que du temps d’Abraham Paris fût au pied des Alpes, ou que la Seine traversât l’Espagne, et de mêler de pareilles grotesques dans une pièce d’invention. Mais l’histoire est des choses qui passent, et qui succédant les unes aux autres, n’ont que chacune un moment pour leur durée, dont il en échappe beaucoup à la connaissance de ceux qui l’écrivent. Aussi n’en peut-on montrer aucune qui contienne tout ce qui s’est passé dans les lieux dont elle parle, ni tout ce qu’ont fait ceux dont elle décrit la vie. Je n’en excepte pas même les Commentaires de César, qui écrivait sa propre histoire, et devait la savoir tout entière. Nous savons quels pays arrosaient le Rhône et la Seine avant qu’il vînt dans les Gaules; mais nous ne savons que fort peu de chose, et peut-être rien du tout, de ce qui s’y est passé avant sa venue. Ainsi nous pouvons bien y placer des actions que nous feignons arrivées avant ce temps-là, mais non pas, sous ce prétexte de fiction poétique et d’éloignement des temps, y changer la distance naturelle d’un lieu à l’autre. C’est de cette façon que Barclay en a usé dans son Argenis, où il ne nomme aucune ville ni fleuve de Sicile, ni de nos provinces, que par des noms véritables, bien que ceux de toutes les personnes qu’il y met sur le tapis soient entièrement de son invention aussi bien que leurs actions. Aristote semble plus indulgent sur cet article, puisqu’il trouve le poète excusable quand il pèche contre un autre art que le sien, comme contre la médecine ou contre l’astrologie. A quoi je réponds qu’il ne l’excuse que sous cette condition qu’il arrive par là au but de son art, auquel il n’aurait pu arriver autrement; encore avoue-t-il qu’il pèche en ce cas, et qu’il est meilleur de ne pécher point du tout. Pour moi, s’il faut recevoir cette excuse, je ferais distinction entre les arts qu’il peut ignorer sans honte, parce qu’il lui arrive rarement des occasions d’en parler sur son théâtre, tels que sont la médecine et l’astrologie, que je viens de nommer, et les arts sans la connaissance desquels, ou en tout ou en partie, il ne saurait établir de justesse dans aucune pièce, tels que sont la géographie et la chronologie. Comme il ne saurait représenter aucune action sans la placer en quelque lieu et en quelque temps, il est inexcusable s’il fait paraître de l’ignorance dans le choix de ce lieu et de ce temps où il la place. Je viens à l’autre division du vraisemblable en ordinaire et extraordinaire: l’ordinaire est une action qui arrive plus souvent, ou du moins aussi souvent que sa contraire; l’extraordinaire est une action qui arrive, à la vérité, moins souvent que sa contraire, mais qui ne laisse pas d’avoir sa possibilité assez aisée pour n’aller point jusqu’au miracle, ni jusqu’à ces événements singuliers qui servent de matière aux tragédies sanglantes par l’appui qu’ils ont de l’histoire ou de l’opinion commune, et qui ne se peuvent tirer en exemple que pour les épisodes de la pièce dont ils font le corps, parce qu’ils ne sont pas croyables à moins que d’avoir cet appui. Aristote donne deux idées ou exemples généraux de ce vraisemblable extraordinaire: l’un d’un homme subtil et adroit qui se trouve trompé par un moins subtil que lui; l’autre d’un faible qui se bat contre un plus fort que lui et en demeure victorieux, ce qui surtout ne manque jamais à être bien reçu quand la cause du plus simple ou du plus faible est la plus équitable. Il semble alors que la justice du ciel ait présidé au succès, qui trouve d’ailleurs une croyance d’autant plus facile qu’il répond aux souhaits de l’auditoire, qui s’intéresse toujours pour ceux dont le procédé est le meilleur. Ainsi la victoire du Cid contre le Comte se trouverait dans la vraisemblance extraordinaire, quand elle ne serait pas vraie. Il est vraisemblable, dit notre docteur, que beaucoup de choses arrivent contre le vraisemblable; et puisqu’il avoue par là que ces effets extraordinaires arrivent contre la vraisemblance, j’aimerais mieux les nommer simplement croyables, et les ranger sous le nécessaire, attendu qu’on ne s’en doit jamais servir sans nécessité. On peut m’objecter que le même philosophe dit qu’au regard de la poésie on doit préférer l’impossible croyable au possible incroyable, et conclure de là que j’ai peu de raison d’exiger du vraisemblable, par la définition que j’en ai faite, qu’il soit manifestement possible pour être croyable, puisque selon Aristote il y a des choses impossibles qui sont croyables. Pour résoudre cette difficulté, et trouver de quelle nature est cet impossible croyable dont il ne donne aucun exemple, je réponds qu’il y a des choses impossibles en elles-mêmes qui paraissent aisément possibles, et par conséquent croyables, quand on les envisage d’une autre manière. Telles sont toutes celles où nous falsifions l’histoire. Il est impossible qu’elles soient passées comme nous les représentons, puisqu’elles se sont passées autrement, et qu’il n’est pas au pouvoir de Dieu même de rien changer au passé; mais elles paraissent manifestement possibles quand elles sont dans la vraisemblance générale, pourvu qu’on les regarde détachées de l’histoire, et qu’on veuille oublier pour quelque temps ce qu’elle dit de contraire à ce que nous inventons. Tout ce qui se passe dans Nicomède est impossible, puisque l’histoire porte qu’il fit mourir son père sans le voir, et que ses frères du second lit étaient en otage à Rome lorsqu’il s’empara du royaume. Tout ce qui arrive dans Héraclius ne l’est pas moins, puisqu’il n’était pas fils de Maurice, et que bien loin de passer pour celui de Phocas et être nourri comme tel chez ce tyran, il vint fondre sur lui à force ouverte des bords de l’Afrique, dont il était gouverneur, et ne le vit peut-être jamais. On ne prend point néanmoins pour incroyables les incidents de ces deux tragédies; et ceux qui savent le désaveu qu’en fait l’histoire la mettent aisément à quartier pour se plaire à leur représentation, parce qu’ils sont dans la vraisemblance générale, bien qu’ils manquent de la particulière. Tout ce que la fable nous dit de ses Dieux et de ses métamorphoses est encore impossible, et ne laisse pas d’être croyable par l’opinion commune, et par cette vieille traditive qui nous a accoutumés à en ouïr parler. Nous avons droit d’inventer même sur ce modèle, et de joindre des incidents également impossibles à ceux que ces anciennes erreurs nous prêtent. L’auditeur n’est point trompé de son attente, quand le titre du poème le prépare à n’y voir rien que d’impossible en effet: il y trouve tout croyable; et cette première supposition faite qu’il est des Dieux, et qu’ils prennent intérêt et font commerce avec les hommes, à quoi il vient tout résolu, il n’a aucune difficulté à se persuader du reste. Après avoir tâché d’éclaircir ce que c’est que le vraisemblable, il est temps que je hasarde une définition du nécessaire dont Aristote parle tant, et qui seul nous peut autoriser à changer l’histoire et à nous écarter de la vraisemblance. Je dis donc que le nécessaire, en ce qui regarde la poésie, n’est autre chose que le besoin du poète pour arriver à son but ou pour y faire arriver ses acteurs. Cette définition a son fondement sur les diverses acceptions du mot grec ***, qui ne signifie pas toujours ce qui est absolument nécessaire, mais aussi quelquefois ce qui est seulement utile à parvenir à quelque chose. Le but des acteurs est divers, selon les divers desseins que la variété des sujets leur donne. Un amant a celui de posséder sa maîtresse; un ambitieux, de s’emparer d’une couronne; un homme offensé, de se venger; et ainsi des autres. Les choses qu’ils ont besoin de faire pour y arriver constituent ce nécessaire, qu’il faut préférer au vraisemblable, ou pour parler plus juste, qu’il faut ajouter au vraisemblable dans la liaison des actions, et leur dépendance l’une de l’autre. Je pense m’être déjà assez expliqué là-dessus; je n’en dirai pas davantage. Le but du poète est de plaire selon les règles de son art. Pour plaire, il a besoin quelquefois de rehausser l’éclat des belles actions et d’exténuer l’horreur des funestes. Ce sont des nécessités d’embellissement où il peut bien choquer la vraisemblance particulière par quelque altération de l’histoire, mais non pas se dispenser de la générale, que rarement, et pour des choses qui soient de la dernière beauté, et si brillantes, qu’elles éblouissent. Surtout il ne doit jamais les pousser au-delà de la vraisemblance extraordinaire, parce que ces ornements qu’il ajoute de son invention ne sont pas d’une nécessité absolue, et qu’il fait mieux de s’en passer tout à fait que d’en parer son poème contre toute sorte de vraisemblance. Pour plaire selon les règles de son art, il a besoin de renfermer son action dans l’unité de jour et de lieu; et comme cela est d’une nécessité absolue et indispensable, il lui est beaucoup plus permis sur ces deux articles que sur celui des embellissements. Il est si malaisé qu’il se rencontre dans l’histoire ni dans l’imagination des hommes quantité de ces événements illustres et dignes de la tragédie, dont les délibérations et leurs effets puissent arriver en un même lieu et en un même jour, sans faire un peu de violence à l’ordre commun des choses, que je ne puis croire cette sorte de violence tout à fait condamnable, pourvu qu’elle n’aille pas jusqu’à l’impossible. Il est de beaux sujets où on ne la peut éviter; et un auteur scrupuleux se priverait d’une belle occasion de gloire, et le public de beaucoup de satisfaction, s’il n’osait s’enhardir à les mettre sur le théâtre, de peur de se voir forcé à les faire aller plus vite que la vraisemblance ne le permet. Je lui donnerais en ce cas un conseil que peut-être il trouverait salutaire: c’est de ne marquer aucun temps préfix dans son poème, ni aucun lieu déterminé où il pose ses acteurs. L’imagination de l’auditeur aurait plus de liberté de se laisser aller au courant de l’action, si elle n’était point fixée par ces marques; et il pourrait ne s’apercevoir pas de cette précipitation, si elles ne l’en faisaient souvenir, et n’y appliquaient son esprit malgré lui. Je me suis toujours repenti d’avoir fait dire au Roi, dans le Cid, qu’il voulait que Rodrigue se délassât une heure ou deux après la défaite des Maures avant que de combattre don Sanche: je l’avais fait pour montrer que la pièce était dans les vingt-quatre heures; et cela n’a servi qu’à avertir les spectateurs de la contrainte avec laquelle je l’y ai réduite. Si j’avais fait résoudre ce combat sans en désigner l’heure, peut-être n’y aurait-on pas pris garde. Je ne pense pas que dans la comédie le poète ait cette liberté de presser son action, par la nécessité de la réduire dans l’unité de jour. Aristote veut que toutes les actions qu’il y fait entrer soient vraisemblables, et n’ajoute point ce mot: ou nécessaires, comme pour la tragédie. Aussi la différence est assez grande entre les actions de l’une et celles de l’autre. Celles de la comédie partent de personnes communes, et ne consistent qu’en intriques d’amour et en fourberies, qui se développent si aisément en un jour, qu’assez souvent, chez Plaute et chez Térence, le temps de leur durée excède à peine celui de leur représentation; mais dans la tragédie les affaires publiques sont mêlées d’ordinaire avec les intérêts particuliers des personnes illustres qu’on y fait paraître; il y entre des batailles, des prises de villes, de grands périls, des révolutions d’États; et tout cela va malaisément avec la promptitude que la règle nous oblige de donner à ce qui se passe sur la scène. Si vous me demandez jusqu’où peut s’étendre cette liberté qu’a le poète d’aller contre la vérité et contre la vraisemblance, par la considération du besoin qu’il en a, j’aurai de la peine à vous faire une réponse précise. J’ai fait voir qu’il y a des choses sur qui nous n’avons aucun droit; et pour celles où ce privilège peut avoir lieu, il doit être plus ou moins resserré, selon que les sujets sont plus ou moins connus. Il m’était beaucoup moins permis dans Horace et dans Pompée, dont les histoires ne sont ignorées de personne, que dans Rodogune et dans Nicomède, dont peu de gens savaient les noms avant que je les eusse mis sur le théâtre. La seule mesure qu’on y peut prendre, c’est que tout ce qu’on y ajoute à l’histoire, et tous les changements qu’on y apporte, ne soient jamais plus incroyables que ce qu’on en conserve dans le même poème. C’est ainsi qu’il faut entendre ce vers d’Horace touchant les fictions d’ornement: Ficta voluptatis causa sint proxima veris, et non pas en porter la signification jusqu’à celles qui peuvent trouver quelque exemple dans l’histoire ou dans la fable, hors du sujet qu’on traite. Le même Horace décide la question, autant qu’on la peut décider, par cet autre vers avec lequel je finis ce discours: ... Dabiturque licentia sumpta pudenter. Servons-nous-en donc avec retenue, mais sans scrupule; et s’il se peut, ne nous en servons point du tout: il vaut mieux n’avoir point besoin de grâce que d’en recevoir.
Je tiens donc, et je l’ai déjà dit, que l’unité d’action consiste, dans la comédie, en l’unité d’intrique, ou d’obstacle aux desseins des principaux acteurs, et en l’unité de péril dans la tragédie, soit que son héros y succombe, soit qu’il en sorte. Ce n’est pas que je prétende qu’on ne puisse admettre plusieurs périls dans l’une, et plusieurs intriques ou obstacles dans l’autre, pourvu que de l’un on tombe nécessairement dans l’autre; car alors la sortie du premier péril ne rend point l’action complète, puisqu’elle en attire un second; et l’éclaircissement d’un intrique ne met point les acteurs en repos, puisqu’il les embarrasse dans un nouveau. Ma mémoire ne me fournit point d’exemples anciens de cette multiplicité de périls attachés l’un à l’autre qui ne détruit point l’unité d’action; mais j’en ai marqué la duplicité indépendante pour un défaut dans Horace et dans Théodore, dont il n’est point besoin que le premier tue sa soeur au sortir de sa victoire, ni que l’autre s’offre au martyre après avoir échappé la prostitution; et je me trompe fort si la mort de Polyxène et celle d’Astyanax, dans la Troade de Sénèque, ne font la même irrégularité. En second lieu, ce mot d’unité d’action ne veut pas dire que la tragédie n’en doive faire voir qu’une sur le théâtre. Celle que le poète choisit pour son sujet doit avoir un commencement, un milieu et une fin; et ces trois parties non seulement sont autant d’actions qui aboutissent à la principale, mais en outre chacune d’elles en peut contenir plusieurs avec la même subordination. Il n’y doit avoir qu’une action complète, qui laisse l’esprit de l’auditeur dans le calme; mais elle ne peut le devenir que par plusieurs autres imparfaites, qui lui servent d’acheminements, et tiennent cet auditeur dans une agréable suspension. C’est ce qu’il faut pratiquer à la fin de chaque acte pour rendre l’action continue. Il n’est pas besoin qu’on sache précisément tout ce que font les acteurs durant les intervalles qui les séparent, ni même qu’ils agissent lorsqu’ils ne paraissent point sur le théâtre; mais il est nécessaire que chaque acte laisse une attente de quelque chose qui se doive faire dans celui qui le suit. Si vous me demandiez ce que fait Cléopâtre dans Rodogune, depuis qu’elle a quitté ses deux fils au second acte jusqu’à ce qu’elle rejoigne Antiochus au quatrième, je serais bien empêché à vous le dire, et je ne crois pas être obligé à en rendre compte; mais la fin de ce second prépare à voir un effort de l’amitié des deux frères pour régner, et dérober Rodogune à la haine envenimée de leur mère. On en voit l’effet dans le troisième, dont la fin prépare encore à voir un autre effort d’Antiochus pour regagner ces deux ennemies l’une après l’autre, et à ce que fait Séleucus dans le quatrième, qui oblige cette mère dénaturée à résoudre et faire attendre ce qu’elle tâche d’exécuter au cinquième. Dans le Menteur, tout l’intervalle du troisième au quatrième vraisemblablement se consume à dormir par tous les acteurs; leur repos n’empêche pas toutefois la continuité d’action entre ces deux actes, parce que ce troisième n’en a point de complète. Dorante le finit par le dessein de chercher des moyens de regagner l’esprit de Lucrèce; et dès le commencement de l’autre il se présente pour tâcher de parler à quelqu’un de ses gens, et prendre l’occasion de l’entretenir elle-même si elle se montre. Quand je dis qu’il n’est pas besoin de rendre compte de ce que font les acteurs cependant qu’ils n’occupent point la scène, je n’entends pas dire qu’il ne soit quelquefois fort à propos de le rendre, mais seulement qu’on n’y est pas obligé, et qu’il n’en faut prendre le soin que quand ce qui s’est fait derrière le théâtre sert à l’intelligence de ce qui se doit faire devant les spectateurs. Ainsi je ne dis rien de ce qu’a fait Cléopâtre depuis le second acte jusques au quatrième, parce que durant tout ce temps-là elle a pu ne rien faire d’important pour l’action principale que je prépare; mais je fais connaître, dès le premier vers du cinquième, qu’elle a employé tout l’intervalle d’entre ces deux derniers à tuer Séleucus, parce que cette mort fait une partie de l’action. C’est ce qui me donne lieu de remarquer que le poète n’est pas tenu d’exposer à la vue toutes les actions particulières qui amènent à la principale: il doit choisir celles qui lui sont les plus avantageuses à faire voir, soit par la beauté du spectacle, soit par l’éclat et la véhémence des passions qu’elles produisent, soit par quelque autre agrément qui leur soit attaché, et cacher les autres derrière la scène, pour les faire connaître au spectateur, ou par une narration, ou par quelque autre adresse de l’art; surtout il doit se souvenir que les unes et les autres doivent avoir une telle liaison ensemble, que les dernières soient produites par celles qui les précèdent, et que toutes aient leur source dans la protase que doit fermer le premier acte. Cette règle, que j’ai établie dès le premier Discours, bien qu’elle soit nouvelle et contre l’usage des anciens, a son fondement sur deux passages d’Aristote. En voici le premier: Il y a grande différence, dit-il, entre les événements qui viennent les uns après les autres, et ceux qui viennent les uns à cause des autres. Les Maures viennent dans le Cid après la mort du Comte, et non pas à cause de la mort du Comte; et le pêcheur vient dans Don Sanche après qu’on soupçonne Carlos d’être le prince d’Aragon, et non pas à cause qu’on l’en soupçonne; ainsi tous les deux sont condamnables. Le second passage est encore plus formel, et porte en termes exprès, que tout ce qui se passe dans la tragédie doit arriver nécessairement ou vraisemblablement de ce qui l’a précédé. La liaison des scènes qui unit toutes les actions particulières de chaque acte l’une avec l’autre, et dont j’ai parlé en l’examen de la Suivante, est un grand ornement dans un poème, et qui sert beaucoup à former une continuité d’action par la continuité de la représentation; mais enfin ce n’est qu’un ornement et non pas une règle. Les anciens ne s’y sont pas toujours assujettis, bien que la plupart de leurs actes ne soient chargés que de deux ou trois scènes; ce qui la rendait bien plus facile pour eux que pour nous, qui leur en donnons quelquefois jusqu’à neuf ou dix. Je ne rapporterai que deux exemples du mépris qu’ils en ont fait: l’un est de Sophocle dans l’Ajax, dont le monologue, avant que de se tuer, n’a aucune liaison avec la scène qui le précède, ni avec celle qui le suit; l’autre est du troisième acte de l’Eunuque de Térence, où celle d’Antiphon seul n’a aucune communication avec Chrémès et Pythias, qui sortent du théâtre quand il y entre. Les savants de notre siècle, qui les ont pris pour modèles dans les tragédies qu’ils nous ont laissées, ont encore plus négligé cette liaison qu’eux; et il ne faut que jeter l’oeil sur celles de Buchanan, de Grotius et de Heinsius, dont j’ai parlé dans l’examen de Polyeucte, pour en demeurer d’accord. Nous y avons tellement accoutumé nos spectateurs, qu’ils ne sauraient plus voir une scène détachée sans la marquer pour un défaut: l’oeil et l’oreille même s’en scandalisent avant que l’esprit y ait pu faire de réflexion. Le quatrième acte de Cinna demeure au-dessous des autres par ce manquement; et ce qui n’était point une règle autrefois l’est devenu maintenant par l’assiduité de la pratique. J’ai parlé de trois sortes de liaisons dans cet examen de la Suivante: j’ai montré aversion pour celles de bruit, indulgence pour celles de vue, estime pour celles de présence et de discours; et dans ces dernières j’ai confondu deux choses qui méritent d’être séparées. Celles qui sont de présence et de discours ensemble ont sans doute toute l’excellence dont elles sont capables; mais il en est de discours sans présence, et de présence sans discours, qui ne sont pas dans le même degré. Un acteur qui parle à un autre d’un lieu caché, sans se montrer, fait une liaison de discours sans présence, qui ne laisse pas d’être fort bonne; mais cela arrive fort rarement. Un homme qui demeure sur le théâtre, seulement pour entendre ce que diront ceux qu’il y voit entrer, fait une liaison de présence sans discours, qui souvent a mauvaise grâce, et tombe dans une affectation mendiée, plutôt pour remplir ce nouvel usage qui passe en précepte, que pour aucun besoin qu’en puisse avoir le sujet. Ainsi dans le troisième acte de Pompée, Achorée, après avoir rendu compte à Charmion de la réception que César a faite au Roi quand il lui a présenté la tête de ce héros, demeure sur le théâtre, où il voit venir l’un et l’autre, seulement pour entendre ce qu’ils diront, et le rapporter à Cléopâtre. Ammon fait la même chose au quatrième d’Andromède, en faveur de Phinée, qui se retire à la vue du Roi et de toute sa cour, qu’il voit arriver. Ces personnages qui deviennent muets lient assez mal les scènes, où ils ont si peu de part qu’ils n’y sont comptés pour rien. Autre chose est quand ils se tiennent cachés pour s’instruire de quelque secret d’importance par le moyen de ceux qui parlent, et qui croient n’être entendus de personne; car alors l’intérêt qu’ils ont à ce qui se dit, joint à une curiosité raisonnable d’apprendre ce qu’ils ne peuvent savoir d’ailleurs, leur donne grande part en l’action malgré leur silence; mais, en ces deux exemples, Ammon et Achorée mêlent une présence si froide aux scènes qu’ils écoutent, qu’à ne rien déguiser, quelque couleur que je leur donne pour leur servir de prétexte, ils ne s’arrêtent que pour les lier avec celles qui les précèdent, tant l’une et l’autre pièce s’en peut aisément passer. Bien que l’action du poème dramatique doive avoir son unité, il y faut considérer deux parties: le noeud et le dénouement. Le noeud est composé, selon Aristote, en partie de ce qui s’est passé hors du théâtre avant le commencement de l’action qu’on y décrit et en partie de ce qui s’y passe; le reste appartient au dénouement. Le changement d’une fortune en l’autre fait la séparation de ces deux parties. Tout ce qui le précède est de la première; et ce changement avec ce qui le suit regarde l’autre. Le noeud dépend entièrement du choix et de l’imagination industrieuse du poète; et l’on n’y peut donner de règle, sinon qu’il y doit ranger toutes choses selon le vraisemblable ou le nécessaire, dont j’ai parlé dans le second Discours; à quoi j’ajoute un conseil, de s’embarrasser le moins qu’il lui est possible de choses arrivées avant l’action qui se représente. Ces narrations importunent d’ordinaire, parce qu’elles ne sont pas attendues, et qu’elles gênent l’esprit de l’auditeur, qui est obligé de charger sa mémoire de ce qui s’est fait dix ou douze ans auparavant, pour comprendre ce qu’il voit représenter; mais celles qui se font des choses qui arrivent et se passent derrière le théâtre, depuis l’action commencée, font toujours un meilleur effet, parce qu’elles sont attendues avec quelque curiosité, et font partie de cette action qui se représente. Une des raisons qui donne tant d’illustres suffrages à Cinna pour le mettre au-dessus de ce que j’ai fait, c’est qu’il n’y a aucune narration du passé, celle qu’il fait de sa conspiration à Emilie étant plutôt un ornement qui chatouille l’esprit des spectateurs qu’une instruction nécessaire de particularités qu’ils doivent savoir et imprimer dans leur mémoire pour l’intelligence de la suite. Emilie leur fait assez connaître dans les deux premières scènes qu’il conspirait contre Auguste en sa faveur; et quand Cinna lui dirait tout simplement que les conjurés sont prêts au lendemain, il avancerait autant pour l’action que par les cent vers qu’il emploie à lui rendre compte, et de ce qu’il leur a dit, et de la manière dont ils l’ont reçu. Il y a des intriques qui commencent dès la naissance du héros, comme celui d’Héraclius; mais ces grands efforts d’imagination en demandent un extraordinaire à l’attention du spectateur, et l’empêchent souvent de prendre un plaisir entier aux premières représentations, tant ils le fatiguent. Dans le dénouement je trouve deux choses à éviter, le simple changement de volonté, et la machine. Il n’y a pas grand artifice à finir un poème, quand celui qui a fait obstacle aux desseins des premiers acteurs, durant quatre actes, en désiste au cinquième, sans aucun événement notable qui l’y oblige: j’en ai parlé au premier Discours, et n’y ajouterai rien ici. La machine n’a pas plus d’adresse quand elle ne sert qu’à faire descendre un Dieu pour accommoder toutes choses, sur le point que les acteurs ne savent plus comment les terminer. C’est ainsi qu’Apollon agit dans l’Oreste: ce prince et son ami Pylade, accusés par Tyndare et Ménélas de la mort de Clytemnestre, et condamnés à leur poursuite, se saisissent d’Hélène et d’Hermione: ils tuent ou croient tuer la première, et menacent d’en faire autant de l’autre, si on ne révoque l’arrêt prononcé contre eux. Pour apaiser ces troubles, Euripide ne cherche point d’autre finesse que de faire descendre Apollon du ciel, qui d’autorité absolue ordonne qu’Oreste épouse Hermione, et Pylade Electre; et de peur que la mort d’Hélène n’y servît d’obstacle, n’y ayant pas d’apparence qu’Hermione épousât Oreste qui venait de tuer sa mère, il leur apprend qu’elle n’est pas morte, et qu’il l’a dérobée à leurs coups, et enlevée au ciel dans l’instant qu’ils pensaient la tuer. Cette sorte de machine est entièrement hors de propos, n’ayant aucun fondement sur le reste de la pièce, et fait un dénouement vicieux. Mais je trouve un peu de rigueur au sentiment d’Aristote, qui met en même rang le char dont Médée se sert pour s’enfuir de Corinthe après la vengeance qu’elle a prise de Créon. Il me semble que c’en est un assez grand fondement que de l’avoir faite magicienne, et d’en avoir rapporté dans le poème des actions autant au-dessus des forces de la nature que celle-là. Après ce qu’elle a fait pour Jason à Colchos, après qu’elle a rajeuni son père Eson depuis son retour, après qu’elle a attaché des feux invisibles au présent qu’elle a fait à Créuse, ce char volant n’est point hors de la vraisemblance; et ce poème n’a point besoin d’autre préparation pour cet effet extraordinaire. Sénèque lui en donne une par ce vers, que Médée dit à sa nourrice: Tuum quoque ipsa corpus hinc mecum aveham; et moi, par celui-ci qu’elle dit à Egée: “Je vous suivrai demain par un chemin nouveau.” Ainsi la condamnation d’Euripide, qui ne s’y est servi d’aucune précaution, peut être juste, et ne retomber ni sur Sénèque, ni sur moi; et je n’ai point besoin de contredire Aristote pour me justifier sur cet article. De l’action je passe aux actes, qui en doivent contenir chacun une portion, mais non pas si égale qu’on n’en réserve plus pour le dernier que pour les autres, et qu’on n’en puisse moins donner au premier qu’aux autres. On peut même ne faire autre chose dans ce premier que peindre les moeurs des personnages, et marquer à quel point ils en sont de l’histoire qu’on va représenter. Aristote n’en prescrit point le nombre; Horace le borne à cinq; et bien qu’il défende d’y en mettre moins, les Espagnols s’opiniâtrent à l’arrêter à trois, et les Italiens souvent la même chose. Les Grecs les distinguaient par le chant du choeur, et comme je trouve lieu de croire qu’en quelques-uns de leurs poèmes ils le faisaient chanter plus de quatre fois, je ne voudrais pas répondre qu’ils ne les poussassent jamais au-delà de cinq. Cette manière de les distinguer était plus incommode que la nôtre; car ou l’on prêtait attention à ce que chantait le choeur, ou l’on n’y en prêtait point: si l’on y en prêtait, l’esprit de l’auditeur était trop tendu, et n’avait aucun moment pour se délasser; si l’on n’y en prêtait point, son attention était trop dissipée par la longueur du chant, et lorsqu’un autre acte commençait, il avait besoin d’un effort de mémoire pour rappeler en son imagination ce qu’il avait déjà vu, et en quel point l’action était demeurée. Nos violons n’ont aucune de ces deux incommodités: l’esprit de l’auditeur se relâche durant qu’ils jouent, et réfléchit même sur ce qu’il a vu, pour le louer ou le blâmer, suivant qu’il lui a plu ou déplu; et le peu qu’on les laisse jouer lui en laisse les idées si récentes, que quand les acteurs reviennent, il n’a point besoin de se faire d’effort pour rappeler et renouer son attention. Le nombre des scènes dans chaque acte ne reçoit aucune règle; mais comme tout l’acte doit avoir une certaine quantité de vers qui proportionne sa durée à celle des autres, on y peut mettre plus ou moins de scènes, selon qu’elles sont plus ou moins longues, pour employer le temps que tout l’acte ensemble doit consumer. Il faut, s’il se peut, y rendre raison de l’entrée et de la sortie de chaque acteur; surtout pour la sortie je tiens cette règle indispensable, et il n’y a rien de si mauvaise grâce qu’un acteur qui se retire du théâtre seulement parce qu’il n’a plus de vers à dire. Je ne serais pas si rigoureux pour les entrées. L’auditeur attend l’acteur; et bien que le théâtre représente la chambre ou le cabinet de celui qui parle, il ne peut toutefois s’y montrer qu’il ne vienne de derrière la tapisserie, et il n’est pas toujours aisé de rendre raison de ce qu’il vient de faire en ville avant que de rentrer chez lui, puisque même quelquefois il est vraisemblable qu’il n’en est pas sorti. Je n’ai vu personne se scandaliser de voir Emilie commencer Cinna sans dire pourquoi elle vient dans sa chambre: elle est présumée y être avant que la pièce commence, et ce n’est que la nécessité de la représentation qui la fait sortir de derrière le théâtre pour y venir. Ainsi je dispenserais volontiers de cette rigueur toutes les premières scènes de chaque acte, mais non pas les autres, parce qu’un acteur occupant une fois le théâtre, aucun n’y doit entrer qui n’ait sujet de parler à lui, ou du moins qui n’ait lieu de prendre l’occasion quand elle s’offre. Surtout lorsqu’un acteur entre deux fois dans un acte, soit dans la comédie, soit dans la tragédie, il doit absolument ou faire juger qu’il reviendra bientôt quand il sort la première fois, comme Horace dans le second acte et Julie dans le troisième de la même pièce, ou donner raison en rentrant pourquoi il revient sitôt. Aristote veut que la tragédie bien faite soit belle et capable de plaire sans le secours des comédiens, et hors de la représentation. Pour faciliter ce plaisir au lecteur, il ne faut non plus gêner son esprit que celui du spectateur, parce que l’effort qu’il est obligé de se faire pour la concevoir et se la représenter lui-même dans son esprit diminue la satisfaction qu’il en doit recevoir. Ainsi je serais d’avis que le poète prît grand soin de marquer à la marge les menues actions qui ne méritent pas qu’il en charge ses vers, et qui leur ôteraient même quelque chose de leur dignité, s’il se ravalait à les exprimer. Le comédien y supplée aisément sur le théâtre; mais sur le livre on serait assez souvent réduit à deviner, et quelquefois même on pourrait deviner mal, à moins que d’être instruit par là de ces petites choses. J’avoue que ce n’est pas l’usage des anciens; mais il faut m’avouer aussi que faute de l’avoir pratiqué, ils nous laissent beaucoup d’obscurités dans leurs poèmes, qu’il n’y a que les maîtres de l’art qui puissent développer; encore ne sais-je s’ils en viennent à bout toutes les fois qu’ils se l’imaginent. Si nous nous assujettissions à suivre entièrement leur méthode, il ne faudrait mettre aucune distinction d’actes ni de scènes, non plus que les Grecs. Ce manque est souvent cause que je ne sais combien il y a d’actes dans leurs pièces, ni si à la fin d’un acte un acteur se retire pour laisser chanter le choeur, ou s’il demeure sans action cependant qu’il chante, parce que ni eux ni leurs interprètes n’ont daigné nous en donner un mot d’avis à la marge. Nous avons encore une autre raison particulière de ne pas négliger ce petit secours comme ils ont fait: c’est que l’impression met nos pièces entre les mains des comédiens qui courent les provinces, que nous ne pouvons avertir que par là de ce qu’ils ont à faire, et qui feraient d’étranges contretemps, si nous ne leur aidions par ces notes. Ils se trouveraient bien embarrassés au cinquième acte des pièces qui finissent heureusement, et où nous rassemblons tous les acteurs sur notre théâtre; ce que ne faisaient pas les anciens: ils diraient souvent à l’un ce qui s’adresse à l’autre, principalement quand il faut que le même acteur parle à trois ou quatre l’un après l’autre. Quand il y a quelque commandement à faire à l’oreille, comme celui de Cléopâtre à Laonice pour lui aller querir du poison, il faudrait un a parte pour l’exprimer en vers, si l’on se voulait passer de ces avis en marge; et l’un me semble beaucoup plus insupportable que les autres, qui nous donnent le vrai et unique moyen de faire, suivant le sentiment d’Aristote, que la tragédie soit aussi belle à la lecture qu’à la représentation, en rendant facile à l’imagination du lecteur tout ce que le théâtre présente à la vue des spectateurs. La règle de l’unité de jour a son fondement sur ce mot d’Aristote, que la tragédie doit renfermer la durée de son action dans un tour du soleil, ou tâcher de ne le passer pas de beaucoup. Ces paroles donnent lieu à cette dispute fameuse, si elles doivent être entendues d’un jour naturel de vingt-quatre heures, ou d’un jour artificiel de douze: ce sont deux opinions dont chacune a des partisans considérables; et pour moi, je trouve qu’il y a des sujets si malaisés à renfermer en si peu de temps, que non seulement je leur accorderais les vingt-quatre heures entières, mais je me servirais même de la licence que donne ce philosophe de les excéder un peu, et les pousserais sans scrupule jusqu’à trente. Nous avons une maxime en droit qu’il faut élargir la faveur, et restreindre les rigueurs, odia restringenda, favores ampliandi; et je trouve qu’un auteur est assez gêné par cette contrainte, qui a forcé quelques-uns de nos anciens d’aller jusqu’à l’impossible. Euripide, dans les Suppliantes, fait partir Thésée d’Athènes avec une armée, donner une bataille devant les murs de Thèbes, qui en étaient éloignés de douze ou quinze lieues, et revenir victorieux en l’acte suivant; et depuis qu’il est parti jusqu’à l’arrivée du messager qui vient faire le récit de sa victoire, Ethra et le choeur n’ont que trente-six vers à dire. C’est assez bien employé un temps si court. Eschyle fait revenir Agamemnon de Troie avec une vitesse encore toute autre. Il était demeuré d’accord avec Clytemnestre sa femme que sitôt que cette ville serait prise, il le lui ferait savoir par des flambeaux disposés de montagne en montagne, dont le second s’allumerait incontinent à la vue du premier, le troisième à la vue du second, et ainsi du reste; et par ce moyen elle devait apprendre cette grande nouvelle dès la même nuit. Cependant à peine l’a-t-elle apprise par ces flambeaux allumés, qu’Agamemnon arrive, dont il faut que le navire, quoique battu d’une tempête, si j’ai bonne mémoire, ait été aussi vite, que l’oeil à découvrir ces lumières. Le Cid et Pompée, où les actions sont un peu précipitées, sont bien éloignés de cette licence; et s’ils forcent la vraisemblance commune en quelque chose, du moins ils ne vont point jusqu’à de telles impossibilités. Beaucoup déclament contre cette règle, qu’ils nomment tyrannique, et auraient raison, si elle n’était fondée que sur l’autorité d’Aristote; mais ce qui la doit faire accepter, c’est la raison naturelle qui lui sert d’appui. Le poème dramatique est une imitation, ou pour en mieux parler, un portrait des actions des hommes; et il est hors de doute que les portraits sont d’autant plus excellents qu’ils ressemblent mieux à l’original. La représentation dure deux heures, et ressemblerait parfaitement, si l’action qu’elle représente n’en demandait pas davantage pour sa réalité. Ainsi ne nous arrêtons point ni aux douze, ni aux vingt-quatre heures; mais resserrons l’action du poème dans la moindre durée qu’il nous sera possible, afin que sa représentation ressemble mieux et soit plus parfaite. Ne donnons, s’il se peut, à l’une que les deux heures que l’autre remplit. Je ne crois pas que Rodogune en demande guère davantage, et peut-être qu’elles suffiraient pour Cinna. Si nous ne pouvons la renfermer dans ces deux heures, prenons-en quatre, six, dix, mais ne passons pas de beaucoup les vingt-quatre, de peur de tomber dans le dérèglement, et de réduire tellement le portrait en petit, qu’il n’ait plus ses dimensions proportionnées, et ne soit qu’imperfection. Surtout je voudrais laisser cette durée à l’imagination des auditeurs, et ne déterminer jamais le temps qu’elle emporte, si le sujet n’en avait besoin, principalement quand la vraisemblance y est un peu forcée comme au Cid, parce qu’alors cela ne sert qu’à les avertir de cette précipitation. Lors même que rien n’est violenté dans un poème par la nécessité d’obéir à cette règle, qu’est-il besoin de marquer à l’ouverture du théâtre que le soleil se lève, qu’il est midi au troisième acte, et qu’il se couche à la fin du dernier? C’est une affectation qui ne fait qu’importuner; il suffit d’établir la possibilité de la chose dans le temps où on la renferme, et qu’on le puisse trouver aisément, si on y veut prendre garde, sans y appliquer l’esprit malgré soi. Dans les actions même qui n’ont point plus de durée que la représentation, cela serait de mauvaise grâce si l’on marquait d’acte en acte qu’il s’est passé une demi-heure de l’un à l’autre. Je répète ce que j’ai dit ailleurs, que quand nous prenons un temps plus long, comme de dix heures, je voudrais que les huit qu’il faut perdre se consumassent dans les intervalles des actes, et que chacun d’eux n’eût en son particulier que ce que la représentation en consume, principalement lorsqu’il y a liaison de scènes perpétuelle; car cette liaison ne souffre point de vide entre deux scènes. J’estime toutefois que le cinquième, par un privilège particulier, a quelque droit de presser un peu le temps, en sorte que la part de l’action qu’il représente en tienne davantage qu’il n’en faut pour sa représentation. La raison en est que le spectateur est alors dans l’impatience de voir la fin, et que quand elle dépend d’acteurs qui sont sortis du théâtre, tout l’entretien qu’on donne à ceux qui y demeurent en attendant de leurs nouvelles ne fait que languir, et semble demeurer sans action. Il est hors de doute que depuis que Phocas est sorti au cinquième d’Héraclius jusqu’à ce qu’Amyntas vienne raconter sa mort, il faut plus de temps pour ce qui se fait derrière le théâtre que pour le récit des vers qu’Héraclius, Martian et Pulchérie emploient à plaindre leur malheur. Prusias et Flaminius, dans celui de Nicomède, n’ont pas tout le loisir dont ils auraient besoin pour se rejoindre sur la mer, consulter ensemble, et revenir à la défense de la Reine; et le Cid n’en a pas assez pour se battre contre don Sanche durant l’entretien de l’Infante avec Léonor et de Chimène avec Elvire. Je l’ai bien vu, et n’ai point fait de scrupule de cette précipitation, dont peut-être on trouverait plusieurs exemples chez les anciens; mais ma paresse, dont j’ai déjà parlé, me fera contenter de celui-ci, qui est de Térence dans l’Andrienne. Simon y fait entrer Pamphile son fils chez Glycère, pour en faire sortir le vieillard Criton, et s’éclaircir avec lui de la naissance de sa maîtresse, qui se trouve fille de Chrémès. Pamphile y entre, parle à Criton, le prie de le servir, revient avec lui; et durant cette entrée, cette prière, et cette sortie, Simon et Chrémès, qui demeurent sur le théâtre, ne disent que chacun un vers, qui ne saurait donner tout au plus à Pamphile que le loisir de demander où est Criton, et non pas de parler à lui, et lui dire les raisons qui le doivent porter à découvrir en sa faveur ce qu’il sait de la naissance de cette inconnue. Quand la fin de l’action dépend d’acteurs qui n’ont point quitté le théâtre, et ne font point attendre de leurs nouvelles, comme dans Cinna et dans Rodogune, le cinquième acte n’a point besoin de ce privilège, parce qu’alors toute l’action est en vue; ce qui n’arrive pas quand il s’en passe une partie derrière le théâtre depuis qu’il est commencé. Les autres actes ne méritent point la même grâce. S’il ne s’y trouve pas assez de temps pour y faire rentrer un acteur qui en est sorti, ou pour faire savoir ce qu’il a fait depuis cette sortie, on peut attendre à en rendre compte en l’acte suivant; et le violon, qui les distingue l’un de l’autre, en peut consumer autant qu’il en est besoin; mais dans le cinquième, il n’y a point de remise: l’attention est épuisée, et il faut finir. Je ne puis oublier que, bien qu’il nous faille réduire toute l’action tragique en un jour, cela n’empêche pas que la tragédie ne fasse connaître par narration, ou par quelque autre manière plus artificieuse, ce qu’a fait son héros en plusieurs années, puisqu’il y en a dont le noeud consiste en l’obscurité de sa naissance qu’il faut éclaircir, comme Oedipe. Je ne répéterai point que, moins on se charge d’actions passées, plus on a l’auditeur propice par le peu de gêne qu’on lui donne, en lui rendant toutes les choses présentes, sans demander aucune réflexion à sa mémoire que pour ce qu’il a vu; mais je ne puis oublier que c’est un grand ornement pour un poème que le choix d’un jour illustre et attendu depuis quelque temps. Il ne s’en présente pas toujours des occasions; et dans tout ce que j’ai fait jusqu’ici, vous n’en trouverez de cette nature que quatre: celui d’Horace, où deux peuples devaient décider de leur empire par une bataille; celui de Rodogune, d’Andromède, et de Don Sanche. Dans Rodogune, c’est un jour choisi par deux souverains pour l’effet d’un traité de paix entre leurs couronnes ennemies, pour une entière réconciliation de deux rivales par un mariage, et pour l’éclaircissement d’un secret de plus de vingt ans, touchant le droit d’aînesse entre deux princes gémeaux dont dépend le royaume, et le succès de leur amour. Celui d’Andromède et de Don Sanche ne sont pas de moindre considération; mais comme je le viens de dire, les occasions ne s’en offrent pas souvent; et dans le reste de mes ouvrages, je n’ai pu choisir des jours remarquables que par ce que le hasard y fait arriver, et non pas par l’emploi où l’ordre public les ait destinés de longue main. Quant à l’unité de lieu, je n’en trouve aucun précepte ni dans Aristote ni dans Horace. C’est ce qui porte quelques-uns à croire que la règle ne s’en est établie qu’en conséquence de l’unité du jour, et à se persuader ensuite qu’on le peut étendre jusques où un homme peut aller et revenir en vingt-quatre heures. Cette opinion est un peu licencieuse; et si l’on faisait aller un acteur en poste, les deux côtés du théâtre pourraient représenter Paris et Rouen. Je souhaiterais, pour ne point gêner du tout le spectateur, que ce qu’on fait représenter devant lui en deux heures se pût passer en effet en deux heures, et que ce qu’on lui fait voir sur un théâtre qui ne change point, pût s’arrêter dans une chambre ou dans une salle, suivant le choix qu’on en aurait fait; mais souvent cela est si malaisé, pour ne pas dire impossible, qu’il faut de nécessité trouver quelque élargissement pour le lieu, comme pour le temps. Je l’ai fait voir exact dans Horace, dans Polyeucte et dans Pompée; mais il faut pour cela ou n’introduire qu’une femme, comme dans Polyeucte, ou que les deux qu’on introduit aient tant d’amitié l’une pour l’autre, et des intérêts si conjoints, qu’elles puissent être toujours ensemble, comme dans l’Horace, ou qu’il leur puisse arriver comme dans Pompée, où l’empressement de la curiosité naturelle fait sortir de leurs appartements Cléopâtre au second acte, et Cornélie au cinquième, pour aller jusque dans la grande salle du palais du Roi au-devant des nouvelles qu’elles attendent. Il n’en va pas de même dans Rodogune: Cléopâtre et elle ont des intérêts trop divers pour expliquer leurs plus secrètes pensées en même lieu. Je pourrais en dire ce que j’ai dit de Cinna, où en général tout se passe dans Rome, et en particulier moitié dans le cabinet d’Auguste, et moitié chez Emilie. Suivant cet ordre, le premier acte de cette tragédie serait dans l’antichambre de Rodogune, le second dans la chambre de Cléopâtre, le troisième dans celle de Rodogune; mais si le quatrième peut commencer chez cette princesse, il n’y peut achever, et ce que Cléopâtre y dit à ses deux fils l’un après l’autre y serait mal placé. Le cinquième a besoin d’une salle d’audience où un grand peuple puisse être présent. La même chose se rencontre dans Héraclius. Le premier acte serait fort bien dans le cabinet de Phocas, et le second chez Léontine; mais si le troisième commence chez Pulchérie, il n’y peut achever, et il est hors d’apparence que Phocas délibère dans l’appartement de cette princesse de la perte de son frère. Nos anciens, qui faisaient parler leurs rois en place publique, donnaient assez aisément l’unité rigoureuse de lieu à leurs tragédies. Sophocle toutefois ne l’a pas observée dans son Ajax, qui sort du théâtre afin de trouver un lieu écarté pour se tuer, et s’y tue à la vue du peuple; ce qui fait juger aisément que celui où il se tue n’est pas le même que celui d’où on l’a vu sortir, puisqu’il n’en est sorti que pour en choisir un autre. Nous ne prenons pas la même liberté de tirer les rois et les princesses de leurs appartements; et comme souvent la différence et l’opposition des intérêts de ceux qui sont logés dans le même palais ne souffrent pas qu’ils fassent leurs confidences et ouvrent leurs secrets en même chambre, il nous faut chercher quelque autre accommodement pour l’unité de lieu, si nous la voulons conserver dans tous nos poèmes: autrement il faudrait prononcer contre beaucoup de ceux que nous voyons réussir avec éclat. Je tiens donc qu’il faut chercher cette unité exacte autant qu’il est possible; mais comme elle ne s’accommode pas avec toute sorte de sujets, j’accorderais très volontiers que ce qu’on ferait passer en une seule ville aurait l’unité de lieu. Ce n’est pas que je voulusse que le théâtre représentât cette ville tout entière, cela serait un peu trop vaste, mais seulement deux ou trois lieux particuliers enfermés dans l’enclos de ses murailles. Ainsi la scène de Cinna ne sort point de Rome, et est tantôt l’appartement d’Auguste dans son palais, et tantôt la maison d’Emilie. Le Menteur a les Tuileries et la place Royale dans Paris, et la Suite fait voir la prison et le logis de Mélisse dans Lyon. Le Cid multiplie encore davantage les lieux particuliers sans quitter Séville; et, comme la liaison de scènes n’y est pas gardée, le théâtre, dès le premier acte, est la maison de Chimène, l’appartement de l’Infante dans le palais du Roi, et la place publique; le second y ajoute la chambre du Roi; et sans doute il y a quelque excès dans cette licence. Pour rectifier en quelque façon cette duplicité de lieu quand elle est inévitable, je voudrais qu’on fît deux choses: l’une, que jamais on ne changeât dans le même acte, mais seulement de l’un à l’autre, comme il se fait dans les trois premiers de Cinna; l’autre, que ces deux lieux n’eussent point besoin de diverses décorations, et qu’aucun des deux ne fût jamais nommé, mais seulement le lieu général où tous les deux sont compris, comme Paris, Rome, Lyon, Constantinople, etc. Cela aiderait à tromper l’auditeur, qui ne voyant rien qui lui marquât la diversité des lieux, ne s’en apercevrait pas, à moins d’une réflexion malicieuse et critique, dont il y en a peu qui soient capables, la plupart s’attachant avec chaleur à l’action qu’ils voient représenter. Le plaisir qu’ils y prennent est cause qu’ils n’en veulent pas chercher le peu de justesse pour s’en dégoûter; et ils ne le reconnaissent que par force, quand il est trop visible, comme dans le Menteur et la Suite, où les différentes décorations font reconnaître cette duplicité de lieu, malgré qu’on en ait. Mais comme les personnes qui ont des intérêts opposés ne peuvent pas vraisemblablement expliquer leurs secrets en même place, et qu’ils sont quelquefois introduits dans le même acte avec liaison de scènes qui emporte nécessairement cette unité, il faut trouver un moyen qui la rende compatible avec cette contradiction qu’y forme la vraisemblance rigoureuse, et voir comment pourra subsister le quatrième acte de Rodogune, et le troisième d’Héraclius, où j’ai déjà marqué cette répugnance du côté des deux personnes ennemies qui parlent en l’un et en l’autre. Les jurisconsultes admettent des fictions de droit; et je voudrais, à leur exemple, introduire des fictions de théâtre, pour établir un lieu théâtral qui ne serait ni l’appartement de Cléopâtre, ni celui de Rodogune dans la pièce qui porte ce titre, ni celui de Phocas, de Léontine, ou de Pulchérie, dans Héraclius; mais une salle sur laquelle ouvrent ces divers appartements, à qui j’attribuerais deux privilèges: l’un, que chacun de ceux qui y parleraient fût présumé y parler avec le même secret que s’il était dans sa chambre; l’autre, qu’au lieu que dans l’ordre commun il est quelquefois de la bienséance que ceux qui occupent le théâtre aillent trouver ceux qui sont dans leur cabinet pour parler à eux, ceux-ci pussent les venir trouver sur le théâtre, sans choquer cette bienséance, afin de conserver l’unité de lieu et la liaison des scènes. Ainsi Rodogune dans le premier acte vient trouver Laonice, qu’elle devrait mander pour parler à elle; et dans le quatrième Cléopâtre vient trouver Antiochus au même lieu où il vient de fléchir Rodogune, bien que, dans l’exacte vraisemblance, ce prince devrait aller chercher sa mère dans son cabinet, puisqu’elle hait trop cette princesse pour venir parler à lui dans son appartement, où la première scène fixerait le reste de cet acte, si l’on n’apportait ce tempérament dont j’ai parlé, à la rigoureuse unité de lieu. Beaucoup de mes pièces en manqueront si l’on ne veut point admettre cette modération, dont je me contenterai toujours à l’avenir, quand je ne pourrai satisfaire à la dernière rigueur de la règle. Je n’ai pu y en réduire que trois: Horace, Polyeucte et Pompée. Si je me donne trop d’indulgence dans les autres, j’en aurai encore davantage pour ceux dont je verrai réussir les ouvrages sur la scène avec quelque apparence de régularité. Il est facile aux spéculatifs d’être sévères; mais s’ils voulaient donner dix ou douze poèmes de cette nature au public, ils élargiraient peut-être les règles encore plus que je ne fais, sitôt qu’ils auraient reconnu par l’expérience quelle contrainte apporte leur exactitude, et combien de belles choses elle bannit de notre théâtre. Quoi qu’il en soit, voilà mes opinions, ou si vous voulez, mes hérésies touchant les principaux points de l’art; et je ne sais point mieux accorder les règles anciennes avec les agréments modernes. Je ne doute point qu’il ne soit aisé d’en trouver de meilleurs moyens, et je serai tout prêt de les suivre lorsqu’on les aura mis en pratique aussi heureusement qu’on y a vu les miens. |
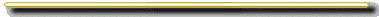 |